riches et multiples aspects. Il y varie à
l'indéfini et ses considérations et sa langue. Mais, sous cette diversité
d'apparence, on observe toujours la même unité organique: c'est partout
la philosophie de la Monade.
[Note 7: LE BARON DE BOINEBOURG, ancien premier conseiller
privé de l'électeur de Mayence Jean-Philippe, grâce auquel Leibniz prit
part aux événements politiques de l'époque.]
[Note 8: LEIBNIZ, N. Essais, p. 371b; _Lettre III à Remond de
Montmort,_ datée de 1714, p. 704b.]
[Note 9: LEIBNIZ, De stylo philosophico Nizol.,p.63 et sqq.]
[Note 10: GUHRAUER, _Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibnitz eine
Biographie,_ t. I, p. 76 et sqq.]
[Note 11: Ibid., t. I, Beil., p. 29.]
Leibniz suit, dans l'exposition de sa doctrine, une sorte de route
ascensionnelle, où l'on va de la matière à la substance, de la substance
à l'âme et de l'âme à Dieu. En outre, il a tout un ensemble de vues
morales qui sont comme l'épanouissement de sa métaphysique et qui
constituent une théorie du bien.
Ce sont ses diverses étapes que l'on va essayer de parcourir à nouveau,
et dans le même ordre.
II.--LA SUBSTANCE
A) NATURE DE LA SUBSTANCE.--On peut dire en un sens «que
tout se fait mécaniquement dans la nature corporelle»; mais il n'en
demeure pas moins vrai «que les principes mêmes de la mécanique,
c'est-à-dire les premières loix du mouvement, ont une origine plus
sublime que celle que les pures mathématiques peuvent fournir[12]».
[Note 12: LEIBNIZ, Si l'essence du corps consiste dans l'étendue, p.
113b; Syst. nouv. de la nature, p. 124b; _Lettre I à Remond de
Montmort_, p. 702a.]
L'essence de la matière demande quelque chose de plus que «la
philosophie corpusculaire[13]».
[Note 13: LEIBNIZ, Correspondance avec Arnauld, p. 632, Ed. P.
Janet, Paris, 1886.]
L'expérience nous apprend que les corps sont divisibles. Et, par
conséquent, il faut qu'antérieurement à toute division ils aient déjà des
parties actuelles; car la division ne crée pas, elle ne fait que compter.
Les corps sont donc des composés. Or tout composé se ramène à des
éléments ultimes, lesquels ne se divisent plus. Supposé, en effet, que
l'on y puisse pousser le partage à l'indéfini; on n'aurait toujours que des
sommes, et jamais des unités: ce qui est contradictoire[14]. De plus, ces
éléments ultimes ne peuvent être étendus, comme l'ont imaginé les
atomistes; car, si petites que l'on fasse les portions de l'étendue, elles
gardent toujours leur nature; elles demeurent divisibles: c'est encore
une pure multitude. Et la raison déjà fournie conserve toute sa force.
[Note 14: Ibid., pp. 631, 654, 655; Syst. nouv. de la nature, p. 24{b}, 3;
Monadol., p. 705{a}, 2.--L'argument de Leibniz suppose que tout ce
qui est divisible contient nécessairement des parties actuelles,
antérieurement à toute division. Or ce principe ne parait pas
suffisamment établi. Pourquoi la théorie aristotélicienne du continu ne
serait-elle pas conforme à la réalité des choses? Quelle raison de croire
que la division n'est pas, au moins en certains cas, un vrai passage de la
puissance à l'acte?]
Ainsi le mécanisme, quelque forme qu'il revête, n'est que
«l'antichambre de la vérité[15]». La conception de Descartes et celle
d'Épicure laissent l'une et l'autre l'esprit en suspens. Une détermination
donnée de l'étendue n'est pas plus une substance «qu'un tas de pierres»,
«l'eau d'un étang avec les poissons y compris[16]», «ou bien un
troupeau de moutons, quand même ces moutons seraient tellement liés
qu'ils ne pussent marcher que d'un pas égal et que l'un ne pût être
touché sans que tous les autres criassent». Il y a autant de différence
entre une substance et un morceau de marbre «qu'il y en a entre un
homme et une communauté, comme peuple, armée, société ou collège,
qui sont des êtres moraux, où il y a quelque chose d'imaginaire et de
dépendant de la fiction de notre esprit[17]». Et l'on peut raisonner de
même au sujet des atomes purement matériels[18]. En les introduisant à
la place du continu, l'on ne change rien qu'aux yeux de l'imagination.
Au fond, c'est métaphysiquement que les corps s'expliquent[19]; car «la
seule matière ne suffit pas pour former une substance». Il y faut «un
être accompli, indivisible»: substantialité signifie simplicité[20].
[Note 15: LEIBNIZ, Lettre I à Remond..., 702{a}.]
[Note 16: LEIBNIZ, Correspondance avec Arnauld, p. 830; _N.
Essais_, p. 238{b},7.]
[Note 17: LEIBNIZ, Correspondance avec Arnauld, p. 631.]
[Note 18: LEIBNIZ, Syst. nouv. de la nature, p. 124b, 3.]
[Note 19: LEIBNIZ, Lettre I à Remond..., p. 702a.]
[Note 20: LEIBNIZ, Correspondance avec Arnauld, p. 631; v. aussi pp.
619, 630, 639, 654, 655; N. Essais, p. 276a, 1; Monadol., p. 705a, 1-3.]
En quoi consistent au juste ces principes indivisibles? quelle est la
nature intime de ces «points métaphysiques», qui constituent les
éléments des choses et qui seuls méritent le nom de substance? Sont-ils
inertes, comme l'a cru Descartes? En aucune manière;
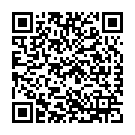
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



