y attachait son honneur, son existence politique, et celle
de la France. Ce système repoussait du continent toutes les
marchandises, ou anglaises, ou qui avaient payé un droit quelconque à
l'Angleterre. Il ne pouvait réussir que par un accord unanime: on ne
devait l'espérer que d'une domination unique et universelle.
D'ailleurs la France s'était aliéné les peuples par ses conquêtes, et les
rois par sa révolution et sa dynastie nouvelle. Elle ne pouvait plus avoir
d'amis ni de rivaux, mais seulement des sujets; car les uns eussent été
faux, et les autres implacables: il fallait donc que tous lui fussent
soumis, ou elle à tous.
C'est ainsi que son chef, entraîné par sa position, et poussé par son
caractère entreprenant, se remplit du vaste projet de rester seul maître
de l'Europe, en écrasant la Russie et en lui arrachant la Pologne. Il le
contenait avec tant de peine que déjà il commençait à lui échapper de
toutes parts. Les immenses préparatifs que nécessitait une si lointaine
entreprise, ces amas de vivres et de munitions, tous ces bruits d'armes,
de chariots, et des pas de tant de soldats, ce mouvement universel, ce
cours majestueux et terrible de toutes les forces de l'Occident contre
l'Orient, tout annonçait à l'Europe que ses deux plus grands colosses
étaient près de se mesurer.
Mais, pour atteindre la Russie, il fallait dépasser l'Autriche, traverser la
Prusse, et marcher entre la Suède et la Turquie: une alliance offensive
avec ces quatre puissances était donc indispensable. L'Autriche était
soumise à l'ascendant de Napoléon, et la Prusse à ses armes; il n'eut
qu'à leur montrer son entreprise: l'Autriche s'y précipita d'elle-même: il
y poussa facilement la Prusse.
Néanmoins la première s'y jeta sans aveuglement. Située entre les deux
colosses du nord et de l'ouest, elle se plut à les voir aux prises; elle
espéra qu'ils s'affaibliraient mutuellement, et que sa force s'accroîtrait
de leur épuisement. Le 14 mars 1812, elle promit trente mille hommes
à la France: mais elle leur prépara en secret de prudentes instructions.
Elle obtint une promesse vague d'agrandissement pour indemnité de ses
frais de guerre, et se fit garantir la possession de la Gallicie. Toutefois
elle admit la possibilité à venir de la cession d'une partie de cette
province au royaume de Pologne; elle eût reçu en dédommagement les
provinces illyriennes: l'article 6 du traité secret en fait foi.
Ainsi le succès de la guerre ne dépendit pas de la cession de la Gallicie,
et des ménagemens qu'imposait la jalousie autrichienne pour cette
possession. Napoléon aurait donc pu, dès son entrée à Wilna, proclamer
ouvertement la libération de toute la Pologne, au lieu de tromper son
attente, de l'étonner, de l'attiédir par des paroles incertaines.
C'était là pourtant un de ces points saillans qui, dans toute affaire de
politique comme de guerre, sont décisifs, auxquels tout se rattache et
sur lesquels il faut s'opiniâtrer. Mais, soit que Napoléon comptât trop
sur l'ascendant de son génie, sur la force de son armée et sur la
faiblesse d'Alexandre; ou qu'envisageant ce qu'il laissait derrière lui, il
crût une guerre si lointaine trop dangereuse à faire lentement et
méthodiquement; soit, comme lui-même va le dire, incertitude sur le
succès de son entreprise, il négligea ou n'osa point encore se décider à
proclamer la libération du pays qu'il venait affranchir.
Et cependant il avait envoyé un ambassadeur à sa diète. Lorsqu'on lui
fit observer cette contradiction, il répliqua «que cette nomination était
un acte de guerre, qui ne l'engageait que pour la guerre, tandis que ses
paroles l'engageraient et pour la guerre et pour la paix.» Aussi ne
l'a-t-on entendu répondre à l'enthousiasme lithuanien que par des
paroles évasives, tandis qu'on l'a vu attaquer Alexandre corps à corps
jusque dans Moskou.
Il négligea même de nettoyer les provinces polonaises du sud des
faibles armées ennemies qui contenaient leur patriotisme, et de s'assurer,
par leur insurrection fortement organisée, une base solide d'opération.
Accoutumé aux voies courtes, à des coups de foudre, il voulut s'imiter
lui-même, malgré la différence des lieux et des circonstances: car telle
est la faiblesse de l'homme, qu'il se conduit toujours par imitation, ou
des autres, ou de lui-même, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, celui des
grands hommes, par l'habitude, qui n'est qu'une imitation de soi-même;
aussi est-ce par leur côté le plus fort que ces hommes extraordinaires
périssent!
Celui-ci s'en remit au destin des batailles. Il s'était préparé une armée
de six cent cinquante mille hommes: il crut que c'était avoir assez fait
pour la victoire. Il attendit tout d'elle. Au lieu de tout sacrifier pour
arriver à cette victoire, c'est par elle qu'il voulut arriver à tout: il s'en
servit comme d'un moyen, quand elle devait être son but. Il la rendit
ainsi trop nécessaire: elle ne l'était déjà que trop. Mais il lui confia tant
d'avenir,
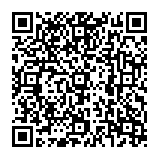
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



