de brouter les feuilles des arbres. Il
admet également une loi de développement progressif; or, comme
toutes les formes de la vie tendent ainsi au perfectionnement, il
explique l'existence actuelle d'organismes très simples par la génération
spontanée. [C'est à l'excellente histoire d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
(Hist. nat. générale, 1859, t. II, p. 405) que j'ai emprunté la date de la
première publication de Lamarck; cet ouvrage contient aussi un résumé
des conclusions de Buffon sur le même sujet. Il est curieux de voir
combien le docteur Erasme Darwin, mon grand-père, dans sa Zoonomia
(vol. I, p. 500-510), publiée en 1794, a devancé Lamarck dans ses idées
et ses erreurs. D'après Isidore Geoffroy, Goethe partageait
complètement les mêmes idées, comme le prouve l'introduction d'un
ouvrage écrit en 1794 et 1795, mais publié beaucoup plus tard. Il a
insisté sur ce point (Goethe als Naturforscher, par le docteur Karl
Meding, p. 34), que les naturalistes auront à rechercher, par exemple,
comment le bétail a acquis ses cornes, et non à quoi elles servent. C'est
là un cas assez singulier de l'apparition à peu près simultanée
d'opinions semblables, car il se trouve que Goethe en Allemagne, le
docteur Darwin en Angleterre, et Geoffroy Saint-Hilaire en France
arrivent, dans les années 1794-95, à la même conclusion sur l'origine
des espèces.]
Geoffroy Saint-Hilaire, ainsi qu'on peut le voir dans l'histoire de sa vie,
écrite par son fils, avait déjà, en 1795, soupçonné que ce que nous
appelons les espèces ne sont que des déviations variées d'un même type.
Ce fut seulement en 1828 qu'il se déclara convaincu que les mêmes
formes ne se sont pas perpétuées depuis l'origine de toutes choses; il
semble avoir regardé les conditions d'existence ou le monde ambiant
comme la cause principale de chaque transformation. Un peu timide
dans ses conclusions, il ne croyait pas que les espèces existantes fussent
en voie de modification; et, comme l'ajoute son fils, «c'est donc un
problème à réserver entièrement à l'avenir, à supposer même que
l'avenir doive avoir prise sur lui.»
Le docteur W.-C. Wells, en 1813, adressa à la Société royale un
mémoire sur une «femme blanche, dont la peau, dans certaines parties,
ressemblait à celle d'un nègre», mémoire qui ne fut publié qu'en 1818
avec ses fameux Two Essays upon Dew and Single Vision. Il admet
distinctement dans ce mémoire le principe de la sélection naturelle, et
c'est la première fois qu'il a été publiquement soutenu; mais il ne
l'applique qu'aux races humaines, et à certains caractères seulement.
Après avoir remarqué que les nègres et les mulâtres échappent à
certaines maladies tropicales, il constate premièrement que tous les
animaux tendent à varier dans une certaine mesure, et secondement que
les agriculteurs améliorent leurs animaux domestiques par la sélection.
Puis il ajoute que ce qui, dans ce dernier cas, est effectué par «l'art
paraît l'être également, mais plus lentement, par la nature, pour la
production des variétés humaines adaptées aux régions qu'elles habitent:
ainsi, parmi les variétés accidentelles qui ont pu surgir chez les
quelques habitants disséminés dans les parties centrales de l'Afrique,
quelques-unes étaient sans doute plus aptes que les autres à supporter
les maladies du pays. Cette race a dû, par conséquent, se multiplier,
pendant que les autres dépérissaient, non seulement parce qu'elles ne
pouvaient résister aux maladies, mais aussi parce qu'il leur était
impossible de lutter contre leurs vigoureux voisins. D'après mes
remarques précédentes, il n'y a pas à douter que cette race énergique ne
fût une race brune. Or, la même tendance à la formation de variétés
persistant toujours, il a dû surgir, dans le cours des temps, des races de
plus en plus noires; et la race la plus noire étant la plus propre à
s'adapter au climat, elle a dû devenir la race prépondérante, sinon la
seule, dans le pays particulier où elle a pris naissance.» L'auteur étend
ensuite ces mêmes considérations aux habitants blancs des climats plus
froids. Je dois remercier M. Rowley, des États-Unis, d'avoir, par
l'entremise de M. Brace, appelé mon attention sur ce passage du
mémoire du docteur Wells.
L'honorable et révérend W. Hebert, plus tard doyen de Manchester,
écrivait en 1822, dans le quatrième volume des Horticultural
Transactions, et dans son ouvrage sur les Amarylliadacées (1837, p. 19,
339), que «les expériences d'horticulture ont établi, sans réfutation
possible, que les espèces botaniques ne sont qu'une classe supérieure de
variétés plus permanentes.» Il étend la même opinion aux animaux, et
croit que des espèces uniques de chaque genre ont été créées dans un
état primitif très plastique, et que ces types ont produit ultérieurement,
principalement par entre-croisement et aussi par variation, toutes nos
espèces existantes.
En 1826, le professeur Grant, dans le dernier paragraphe de son
mémoire bien connu sur les spongilles (Edinburg Philos. Journal, 1826,
t. XIV, p. 283), déclare nettement qu'il croit que les
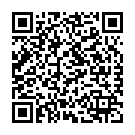
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



