espèces descendent
d'autres espèces, et qu'elles se perfectionnent dans le cours des
modifications qu'elles subissent. Il a appuyé sur cette même opinion
dans sa cinquante-cinquième conférence, publiée en 1834 dans the
Lancet.
En 1831, M. Patrick Matthew a publié un traité intitulé Naval Timber
and Arboriculture, dans lequel il émet exactement la même opinion que
celle que M. Wallace et moi avons exposée dans le Linnean Journal, et
que je développe dans le présent ouvrage. Malheureusement, M.
Matthew avait énoncé ses opinions très brièvement et par passages
disséminés dans un appendice à un ouvrage traitant un sujet tout
différent; elles passèrent donc inaperçues jusqu'à ce que M. Matthew
lui-même ait attiré l'attention sur elles dans le Gardener's Chronicle (7
avril 1860). Les différences entre nos manières de voir n'ont pas grande
importance.
Il semble croire que le monde a été presque dépeuplé à des périodes
successives, puis repeuplé de nouveau; il admet, à titre d'alternative,
que de nouvelles formes peuvent se produire «sans l'aide d'aucun moule
ou germe antérieur». Je crois ne pas bien comprendre quelques
passages, mais il me semble qu'il accorde beaucoup d'influence à
l'action directe des conditions d'existence. Il a toutefois établi
clairement toute la puissance du principe de la sélection naturelle.
Dans sa Description physique des îles Canaries (1836, p.147), le
célèbre géologue et naturaliste von Buch exprime nettement l'opinion
que les variétés se modifient peu à peu et deviennent des espèces
permanentes, qui ne sont plus capables de s'entrecroiser.
Dans la Nouvelle Flore de l'Amérique du Nord (1836, p. 6), Rafinesque
s'exprimait comme suit: «Toutes les espèces ont pu autrefois être des
variétés, et beaucoup de variétés deviennent graduellement des espèces
en acquérant des caractères permanents et particuliers;» et, un peu plus
loin, il ajoute (p. 18): «les types primitifs ou ancêtres du genre
exceptés.»
En 1843-44, dans le Boston Journal of Nat. Hist. U. S. (t.1V, p. 468), le
professeur Haldeman a exposé avec talent les arguments pour et contre
l'hypothèse du développement et de la modification de l'espèce; il paraît
pencher du côté de la variabilité.
Les Vestiges of Creation ont paru en 1844. Dans la dixième édition,
fort améliorée (1853), l'auteur anonyme dit (p. 155): «La proposition à
laquelle on peut s'arrêter après de nombreuses considérations est que
les diverses séries d'êtres animés, depuis les plus simples et les plus
anciens jusqu'aux plus élevés et aux plus récents, sont, sous la
providence de Dieu, le résultat de deux causes: premièrement, d'une
impulsion communiquée aux formes de la vie; impulsion qui les pousse
en un temps donné, par voie de génération régulière, à travers tous les
degrés d'organisation, jusqu'aux Dicotylédonées et aux vertébrés
supérieurs; ces degrés sont, d'ailleurs, peu nombreux et généralement
marqués par des intervalles dans leur caractère organique, ce qui nous
rend si difficile dans la pratique l'appréciation des affinités;
secondement, d'une autre impulsion en rapport avec les forces vitales,
tendant, dans la série des générations, à approprier, en les modifiant, les
conformations organiques aux circonstances extérieures, comme la
nourriture, la localité et les influences météoriques; ce sont là les
adaptations du théologien naturel.» L'auteur paraît croire que
l'organisation progresse par soubresauts, mais que les effets produits
par les conditions d'existence sont graduels. Il soutient avec assez de
force, en se basant sur des raisons générales, que les espèces ne sont
pas des productions immuables. Mais je ne vois pas comment les deux
«impulsions» supposées peuvent expliquer scientifiquement les
nombreuses et admirables coadaptations que l'on remarque dans la
nature; comment, par exemple, nous pouvons ainsi nous rendre compte
de la marche qu'a dû suivre le pic pour s'adapter à ses habitudes
particulières. Le style brillant et énergique de ce livre, quoique
présentant dans les premières éditions peu de connaissances exactes et
une grande absence de prudence scientifique, lui assura aussitôt un
grand succès; et, à mon avis, il a rendu service en appelant l'attention
sur le sujet, en combattant les préjugés et en préparant les esprits à
l'adoption d'idées analogues.
En 1846, le vétéran de la zoologie, M. J. d'Omalius d'Halloy, a publié
(Bull. de l'Acad. roy. de Bruxelles, vol. XIII, p.581) un mémoire
excellent, bien que court, dans lequel il émet l'opinion qu'il est plus
probable que les espèces nouvelles ont été produites par descendance
avec modifications plutôt que créées séparément; l'auteur avait déjà
exprimé cette opinion en 1831.
Dans son ouvrage Nature of Limbs, p. 86, le professeur Owen écrivait
en 1849: «L'idée archétype s'est manifestée dans la chair sur notre
planète, avec des modifications diverses, longtemps avant l'existence
des espèces animales qui en sont actuellement l'expression. Mais
jusqu'à présent nous ignorons entièrement à quelles lois naturelles ou à
quelles causes secondaires la succession régulière et la progression de
ces phénomènes organiques ont pu être soumises.» Dans son discours à
l'Association britannique, en 1858, il parle (p. 51) de «l'axiome de
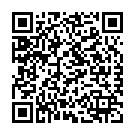
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



