ET DE
L'ÉTENDUE DES DÉNUDATIONS. PAUVRETÉ DE NOS
COLLECTIONS PALÉONTOLOGIQUES. DE L'ABSENCE DE
NOMBREUSES VARIÉTÉS INTERMÉDIAIRES DANS UNE
FORMATION QUELCONQUE. APPARITION SOUDAINE DE
GROUPES ENTIERS D'ESPÈCES ALLIÉES. DE L'APPARITION
SOUDAINE DE GROUPES D'ESPÈCES ALLIÉES DANS LES
COUCHES FOSSILIFÈRES LES PLUS ANCIENNES. RÉSUMÉ.
CHAPITRE XI. DE LA SUCCESSION GÉOLOGIQUE DES ÊTRES
ORGANISÉS. EXTINCTION. DES CHANGEMENTS PRESQUE
INSTANTANÉS DES FORMES VIVANTES DANS LE MONDE.
DES AFFINITÉS DES ESPÈCES ÉTEINTES LES UNES AVEC LES
AUTRES ET AVEC LES FORMES VIVANTES. DU DEGRÉ DE
DEVELOPPEMENT DES FORMES ANCIENNES COMPARÉ À
CELUI DES FORMES VIVANTES. DE LA SUCCESSION DES
MÊMES TYPES DANS LES MÊMES ZONES PENDANT LES
DERNIÈRES PÉRIODES TERTIAIRES. RÉSUMÉ DE CE
CHAPITRE ET DU CHAPITRE PRÉCÉDENT. CHAPITRE XII.
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. CENTRES UNIQUES DE
CRÉATION. MOYENS DE DISPERSION. DISPERSION PENDANT
LA PÉRIODE GLACIAIRE. PÉRIODES GLACIAIRES
ALTERNANTES AU NORD ET AU MIDI. CHAPITRE XIII.
DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE (SUITE). PRODUCTIONS
D'EAU DOUCE. LES HABITANTS DES ÎLES OCÉANIQUES.
ABSENCE DE BATRACIENS ET DE MAMMIFÈRES
TERRESTRES DANS LES ÎLES OCÉANIQUES. SUR LES
RAPPORTS ENTRE LES HABITANTS DES ÎLES ET CEUX DU
CONTINENT LE PLUS RAPPROCHÉ. RÉSUMÉ DE CE
CHAPITRE ET DU CHAPITRE PRÉCÉDENT. CHAPITRE XIV.
AFFINITÉS MUTUELLES DES ÊTRES ORGANISÉS;
MORPHOLOGIE; EMBRYOLOGIE; ORGANES RUDIMENTAIRES.
CLASSIFICATION. RESSEMBLANCES ANALOGUES. SUR LA
NATURE DES AFFINITÉS RELIANT LES ÊTRES ORGANISÉS.
MORPHOLOGIE. DÉVELOPPEMENT ET EMBRYOLOGIE.
ORGANES RUDIMENTAIRES, ATROPHIÉS ET AVORTÉS.
RÉSUMÉ. CHAPITRE XV. RÉCAPITULATION ET
CONCLUSIONS. GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES
SCIENTIFIQUES EMPLOYÉS DANS LE PRESENT VOLUME.
NOTICE HISTORIQUE SUR LES PROGRÈS DE L'OPINION
RELATIVE À L'ORIGINE DES ESPÈCES AVANT LA
PUBLICATION DE LA PREMIÈRE ÉDITION ANGLAISE DU
PRÉSENT OUVRAGE.
Je me propose de passer brièvement en revue les progrès de l'opinion
relativement à l'origine des espèces. Jusque tout récemment, la plupart
des naturalistes croyaient que les espèces sont des productions
immuables créées séparément. De nombreux savants ont habilement
soutenu cette hypothèse. Quelques autres, au contraire, ont admis que
les espèces éprouvent des modifications et que les formes actuelles
descendent de formes préexistantes par voie de génération régulière. Si
on laisse de côté les allusions qu'on trouve à cet égard dans les auteurs
de l'antiquité, [Aristote, dans ses Physicoe Auscultationes (lib. II, cap.
VIII, § 2), après avoir remarqué que la pluie ne tombe pas plus pour
faire croître le blé qu'elle ne tombe pour l'avarier lorsque le fermier le
bat en plein air, applique le même argument aux organismes et ajoute
(M. Clair Grece m'a le premier signalé ce passage): «Pourquoi les
différentes parties (du corps) n'auraient- elles pas dans la nature ces
rapports purement accidentels? Les dents, par exemple, croissent
nécessairement tranchantes sur le devant de la bouche, pour diviser les
aliments les molaires plates servent à mastiquer; pourtant elles n'ont pas
été faites dans ce but, et cette forme est le résultat d'un accident. Il en
est de même pour les autres parties qui paraissent adaptées à un but.
Partout donc, toutes choses réunies (c'est-à-dire l'ensemble des parties
d'un tout) se sont constituées comme si elles avaient été faites en vue de
quelque chose; celles façonnées d'une manière appropriée par une
spontanéité interne se sont conservées, tandis que, dans le cas contraire,
elles ont péri et périssent encore.» On trouve là une ébauche des
principes de la sélection naturelle; mais les observations sur la
conformation des dents indiquent combien peu Aristote comprenait ces
principes.] Buffon est le premier qui, dans les temps modernes, a traité
ce sujet au point de vue essentiellement scientifique. Toutefois, comme
ses opinions ont beaucoup varié à diverses époques, et qu'il n'aborde ni
les causes ni les moyens de la transformation de l'espèce, il est inutile
d'entrer ici dans de plus amples détails sur ses travaux.
Lamarck est le premier qui éveilla par ses conclusions une attention
sérieuse sur ce sujet. Ce savant, justement célèbre, publia pour la
première fois ses opinions en 1801; il les développa considérablement,
en 1809, dans sa Philosophie zoologique, et subséquemment, en 1815,
dans l'introduction à son Histoire naturelle des animaux sans vertèbres.
Il soutint dans ces ouvrages la doctrine que toutes les espèces, l'homme
compris, descendent d'autres espèces. Le premier, il rendit à la science
l'éminent service de déclarer que tout changement dans le monde
organique, aussi bien que dans le monde inorganique, est le résultat
d'une loi, et non d'une intervention miraculeuse. L'impossibilité
d'établir une distinction entre les espèces et les variétés, la gradation si
parfaite des formes dans certains groupes, et l'analogie des productions
domestiques, paraissent avoir conduit Lamarck à ses conclusions sur
les changements graduels des espèces. Quant aux causes de la
modification, il les chercha en partie dans l'action directe des
conditions physiques d'existence, dans le croisement des formes déjà
existantes, et surtout dans l'usage et le défaut d'usage, c'est-à-dire dans
les effets de l'habitude. C'est à cette dernière cause qu'il semble
rattacher toutes les admirables adaptations de la nature, telles que le
long cou de la girafe, qui lui permet
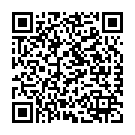
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



