encore aujourd'hui considéré comme le
représentant. Le parti royaliste, de son côté, lui garde rancune de son
évolution vers le libéralisme, de ses intimités avec le parti républicain,
et fait peser, sur ce qu'il appelle sa défection, la responsabilité de la
chute d'un trône. Il n'a donc satisfait personne; il n'est resté l'homme
d'aucun parti; et cela se comprend de la part d'un poète: l'imagination
seule est un guide trompeur, dont la base est fragile, et qui flotte au
hasard parmi les tempêtes de la politique.
Ce que l'esprit de parti surtout n'a pu lui pardonner, ce sont ses
sentiments religieux; on en a discuté l'orthodoxie, on en a même
contesté la sincérité, et le plus éminent critique de notre temps, mais le
moins orthodoxe des hommes, Sainte-Beuve, s'est attaché avec une
sorte d'acharnement à démontrer que Chateaubriand n'était même pas
chrétien, et que toute sa religion formée d'images, de tableaux et de
poésie, n'était qu'une oeuvre d'imagination, presque une hérésie, en
contradiction directe avec les dogmes et l'austérité du christianisme.
Nous ne discuterons pas cette thèse, assez étrange sous la plume de son
auteur; nous ferons seulement observer que le sentiment religieux ne
procède pas uniquement des facultés de la logique et du raisonnement,
mais qu'il peut tout aussi bien trouver sa source dans les sentiments du
coeur et les aspirations de l'imagination. Chateaubriand n'était pas un
dialecticien, c'est évident, mais il était poète, et rien ne s'oppose à ce
qu'un poète soit un chrétien. Le coeur, a dit Pascal, a ses raisons que la
raison ne connaît point: on le sait en mille choses.
Chaque incident de sa vie, ses actions, ses intentions, ses rapports avec
sa famille, sa conduite envers Madame de Chateaubriand, tout a servi
de texte aux incriminations, disons mieux: aux condamnations portées
contre lui.
Cependant la grande figure de Chateaubriand a survécu à toutes les
critiques fondées ou non, et au dénigrement de parti pris contre sa
personne et contre ses oeuvres. C'est que, en effet, si l'on fait
abstraction des côtés faibles qu'on trouve chez tous les hommes autant
ou plus qu'en lui, si, dans son style, on passe condamnation sur
l'exagération de quelques-unes de ses images, en faveur de toutes les
autres, qui sont fort belles, il restera toujours dans ses oeuvres
l'empreinte d'une puissante faculté créatrice, d'une inspiration
supérieure qui anime tous les sujets, les agrandit et les domine, un
souffle poétique qui les parcourt et les élève jusqu'à l'idéal, une sorte de
divination spontanée qui devance et prédit les événements. Amour du
grand et du beau, noblesse et générosité des sentiments, horreur
instinctive de tout ce qui est vil et bas, tels sont quelques-uns des traits
qui caractérisent le génie de Chateaubriand.
Nous n'entreprendrons pas de rectifier toutes les erreurs que nous
venons de signaler, ni d'écrire dans ce but l'histoire complète d'une vie
que les Mémoires d'outre-tombe nous font parfaitement connaître.
Notre tâche est plus bornée: nous voulons seulement apporter quelques
documents nouveaux et inédits sur une période de vie intime, période
limitée, mal connue, et par suite mal comprise.
Cette période est celle de la liaison qui a existé entre Madame de
Custine et Chateaubriand.
Mais pour placer les faits dans leur vrai jour, il est nécessaire de nous
arrêter sur quelques-uns, des événements qui l'ont précédée, et qui
expliquent la situation personnelle de Chateaubriand à l'époque où elle
a commencé.
Nous avons donc à parler d'abord de son mariage, dont l'histoire a été si
étrangement défigurée qu'un écrivain l'a qualifié récemment de
«singulier mariage» sur la foi d'un récit qui exige une rectification, une
réfutation péremptoire.
* * * * *
Suivons d'abord, en le résumant, le récit que Chateaubriand fait de son
mariage dans les Mémoires d'outre-tombe.
Mademoiselle Céleste de Lavigne-Buisson, âgée de dix-sept ans,
orpheline de père et de mère, demeurait à Paramé, près de Saint-Malo,
chez son grand'père, M. de Lavigne, chevalier de Saint-Louis, ancien
commandant de Lorient. Un mariage fut décidé par les soeurs de
Chateaubriand entre elle et leur frère. Le consentement des parents de
la jeune fille fut facilement obtenu, dit Chateaubriand. Un oncle
paternel, M. de Vauvert, seul faisait opposition. On crut pouvoir passer
outre. La pieuse mère de Chateaubriand exigea que la bénédiction
nuptiale fût donnée par un prêtre non assermenté. Le mariage eut lieu
secrètement. M. de Vauvert en eut connaissance et porta plainte. Sous
prétexte de rapt et de violation de la loi, Céleste de Lavigne, devenue
Madame de Chateaubriand, fut enlevée, au nom de la justice, et mise au
couvent de la Victoire à Saint-Malo, en attendant la décision des
tribunaux.
La cause fut plaidée, et le tribunal jugea l'union valide au civil, ajoute
Chateaubriand. M. de Vauvert se désista. Le curé constitutionnel,
largement payé, ne réclama plus contre la première bénédiction
nuptiale, et Madame de Chateaubriand sortit
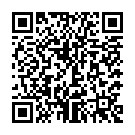
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



