du couvent, où sa soeur
Lucile s'était enfermée avec elle.
Tel est le récit de Chateaubriand; il est confus, embarrassé, manque sur
certains points d'exactitude; sur d'autres, il est en contradiction avec des
documents authentiques. Mais Chateaubriand n'était pas un homme de
loi, et par conséquent il ne faudrait pas exiger de lui la précision d'un
procureur sur les questions de légalité et de procédure que son mariage
a soulevées.
Il y a plusieurs rectifications à faire à son récit.
La famille de Lavigne, contrairement à l'assertion des Mémoires, ne
donnait pas son consentement. Cependant on passa outre; il n'y eut pas
de publicité, pas de bans publiés; qui les aurait publiés, puisque, au plus
fort du schisme introduit dans l'Église par la Constituante, les prêtres
non assermentés n'avaient plus d'église, qu'ils étaient forcés de fuir ou
de se cacher, et qu'ils n'étaient pas plus compétents pour la publication
des bans que pour la célébration du mariage même? La bénédiction
nuptiale, celle que Chateaubriand appelle la première (il y en eut donc
une seconde!), fut donnée sans l'accomplissement d'aucune des
formalités prescrites par la loi alors en vigueur[2].
Il ne faut donc pas s'étonner que sur la plainte des parents de
Mademoiselle de Lavigne, de M. de Vauvert ou de tout autre, la justice
se soit émue et ait commencé contre Chateaubriand une procédure pour
rapt, enlèvement de mineure, violation de la loi, comme le disent les
Mémoires d'outre-tombe.
Mais les choses en étant venues à ce point, la famille, comme il arrive
d'ordinaire en pareil cas, se désista de son opposition et de sa plainte, et
la justice, se prêtant aux circonstances, accorda des délais pour donner
le temps de procéder à un mariage régulier et légal.
C'est, en effet, ce qui eut lieu. Dans l'église paroissiale de Saint-Malo,
le curé constitutionnel et assermenté, M. Duhamel, après publication de
bans, ou avec dispense régulière de publications, célébra publiquement
le mariage de François-Auguste de Chateaubriand et de Céleste de
Lavigne. Acte en fut dressé le jour même, 19 mars 1792, et c'est cet
acte qui, au point de vue légal, constitue l'état civil des deux époux.
Le mariage ainsi célébré par le prêtre compétent, le tribunal
correctionnel, saisi d'une plainte qui se trouvait désormais sans objet,
n'avait plus qu'à prononcer une ordonnance de non-lieu, ou un
acquittement. Mais Chateaubriand a eu tort de dire que la cause a été
plaidée et que le tribunal a jugé valide, au civil, la bénédiction nuptiale
du prêtre insermenté; aucun tribunal n'aurait pu valider un mariage
célébré sans publications, sans publicité, par un prêtre incompétent,
c'est là une première erreur des Mémoires; c'en est une seconde de
prétendre que le curé constitutionnel, grassement payé, ne réclama plus
contre la première bénédiction nuptiale: il réclama si bien que, la
considérant comme non avenue, il administra la seconde, ainsi que les
registres de l'état civil de Saint-Malo en font foi.
Comment expliquer cependant que les Mémoires d'outre-tombe aient
donné une version si peu exacte des faits? La réponse est facile: mariés
légitimement, mais non légalement, par le prêtre insermenté qu'ils
avaient choisi, contraints par des poursuites judiciaires, M. et Madame
de Chateaubriand ont dû se soumettre, comme à une formalité imposée,
à la bénédiction du prêtre qu'ils considéraient comme schismatique;
mais tout en cédant à la nécessité, comme ils l'ont fait, ils n'ont pas
moins continué à reconnaître, dans leur for intérieur, leur première
bénédiction nuptiale comme le seul, le vrai lien religieux qui avait
formé leur union, et il a répugné sans doute à Chateaubriand de faire
l'aveu dans ses Mémoires qu'il ait pu être marié par un prêtre
schismatique.
Les mêmes faits, à cette époque, ont dû se produire fréquemment.
C'était une conséquence inévitable de cette constitution civile du clergé
décrétée par l'Assemblée constituante. Les populations, surtout dans la
Bretagne restée fidèle à ses prêtres persécutés, les suivaient hors des
villes jusque dans les lieux déserts pour entendre la parole de Dieu et
recevoir d'eux les secours de la religion. Que de mariages bénis par eux
n'a-t-il pas fallu faire régulariser ensuite pour se mettre en règle avec la
loi civile!
Il n'y a donc rien d'étrange, comme on l'a prétendu, dans le mariage de
Chateaubriand, et personne, sans doute, ne s'en serait occupé si son
collègue à l'Académie française, M. Viennet, n'avait mis en circulation
une historiette que Sainte-Beuve ne pouvait manquer de recueillir et
qu'il a reproduite en ces termes:
«M. Viennet, dans ses mémoires (inédits) raconte qu'étant entré au
service de la marine vers 1797, il connut à Lorient un riche négociant,
M. Lavigne-Buisson, et se lia avec lui. Quand l'auteur d'Atala
commença à faire du bruit, M. Buisson dit à M. Viennet: «Je le connais,
il a épousé ma nièce, et il l'a épousée de force.» Et il raconta comment
M. de Chateaubriand,
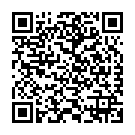
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



