postérité qu'il faut juger les grands
écrivains. Sans doute leurs oeuvres capitales, celles dont la célébrité
retentit à travers les siècles, suffisent pour faire apprécier la nature de
leur talent, pour mettre en relief les qualités maîtresses de leur génie, et
les classer dans l'une ou l'autre des sphères de l'intelligence, suivant que
l'imagination ou le raisonnement prédomine en eux, et en fait des
poètes ou des philosophes, des hommes d'État, des orateurs ou des
historiens. On connaît d'eux, par leurs livres, l'homme public, au plus
haut degré de puissance où ses qualités spéciales ont pu l'élever, mais
son caractère, les tendances particulières de son esprit, sa nature intime,
l'homme privé, en un mot, ne nous sont entièrement révélés que par les
plus secrets détails de sa biographie, par sa correspondance, surtout par
celle qu'il n'a point écrite pour le public.
Et cette étude de l'homme intérieur n'est pas un travail de pure curiosité:
combien d'erreurs ce genre de recherches ne rectifient-elles pas? Ne
sont-elles pas indispensables pour bien comprendre un écrivain dans
ses oeuvres, même les plus élevées? Comment fera-t-on disparaître, par
exemple, si ce n'est par ces documents intimes, ce qu'il y a de
contradictoire et d'inconciliable entre le portrait généralement adopté et
qui devient légendaire d'un Chateaubriand dur, morose, fantasque,
égoïste, et ses oeuvres empreintes d'une sensibilité si vive et de
sentiments si élevés? Ceux de ses amis qui l'ont le mieux connu nous le
peignent, au contraire, doué des qualités les plus charmantes, la
cordialité et l'enjouement, d'une constance inaltérable dans ses
engagements, d'une générosité habituellement prodigue jusqu'à l'excès,
et personne plus que lui n'aurait eu le droit d'écrire, comme il l'a fait:
«Mes amis d'autrefois sont mes amis d'aujourd'hui et ceux de demain.»
Autour de la mémoire de Chateaubriand se sont formés deux camps
opposés; dans l'un, admiration sans bornes, dans l'autre, dénigrement et
implacable condamnation de l'homme et de ses oeuvres. En quoi il n'est
pas probable que, d'un côté ou de l'autre, tous se trompent absolument,
mais chacun examine le même sujet par un côté différent.
Chateaubriand était un poète, non un penseur et un politique; aussi en
littérature a-t-il donné des tableaux et des descriptions dans le style
propre à la poésie, qui est le langage de l'émotion. Qu'y a-t-il d'étonnant,
si l'on exige de lui la profondeur d'une savante analyse, qu'on
s'aperçoive aussitôt qu'il remplace en général le raisonnement par des
images? C'est en vain, par exemple, qu'on chercherait dans le Génie du
christianisme une savante apologie, une démonstration théologique qui
ne s'y trouve pas, et que l'auteur n'avait pas entreprise. Renfermé dans
sa sphère, il est resté poète, et, dans ces limites, il a créé un
chef-d'oeuvre.
En politique, il en est de même. La poésie et la politique diffèrent
essentiellement par leur objet et par la langue même qu'elles emploient.
La poésie, peu importe qu'elle s'exprime en vers ou en prose, vit dans la
sphère des idées les plus générales. La politique, au contraire, n'a pour
objet que des idées particulières, et en cela, elle est inférieure à la
poésie; elle ne s'exerce que sur des faits accidentels et contingents.
Aussi, le poète, sortant de son domaine pour entrer dans celui de la
politique, pourra bien y apporter les idées générales et les plus hautes
aspirations, mais il se sentira toujours mal à l'aise dans la succession
des faits variables qui forment le champ indéfini de l'expérience.
Cette préoccupation des images et de la forme poétique poursuivait
Chateaubriand jusque dans ses études. Il n'avait pas l'érudition d'un
savant, mais il possédait des connaissances variées très étendues. Il
avait beaucoup étudié les littératures antiques; il citait les poètes grecs
avec une évidente prédilection, beaucoup moins souvent les poètes
latins et plus rarement encore les prosateurs, les historiens ou les
philosophes. C'est avec les poètes de la Grèce qu'il était en communion
d'idées; c'est, auprès d'eux qu'il cherchait avec délices la beauté des
formes, la variété et la magnificence des images et les secrets d'une
harmonie qui n'a été surpassée dans aucune autre langue. Il puisait
surtout avec amour à cette source charmante d'inspirations poétiques
qui s'appelle l'Anthologie grecque. Assurément, il aurait applaudi à
l'opinion exprimée par un savant de nos jours: «L'antiquité gréco-latine,
disait Littré, avait amassé des trésors de style sans lesquels rien
d'achevé ne devait plus se produire dans le domaine de la beauté idéale.
L'art antique est à la fois un modèle et un échelon pour l'art
moderne[1].
La politique, la religion, la poésie ont contribué dans des proportions
diverses à soulever contre Chateaubriand l'hostilité persévérante dont
nous avons parlé. En politique, le parti libéral, tout en cherchant et en
parvenant à l'attirer dans son sein et à l'y retenir, n'a point oublié ses
débuts autoritaires et absolutistes, ni son retour, après 1830, aux idées
légitimistes, dont il est
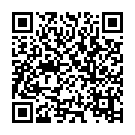
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



