prendre son parti de toutes les hontes; au point où il en est
arrivé, il ne cherche même plus à les dissimuler. La vivacité avec
laquelle il décrit à M. Brook ses souffrances dans le panier au linge sale
n'est plus celle de Falstaff racontant ses exploits contre les voleurs de
Gadshill, et se tirant ensuite si plaisamment d'affaire lorsqu'il est pris en
mensonge. Le besoin de se vanter n'est plus un de ses premiers besoins;
il lui faut de l'argent, avant tout de l'argent, et il ne sera
convenablement châtié que par des inconvénients aussi réels que les
avantages qu'il se promet. Ainsi le panier de linge sale, les coups de
bâton de M. Ford, sont parfaitement adaptés au genre de prétentions qui
attirent à Falstaff une correction pareille; mais bien qu'une telle
aventure puisse, sans aucune difficulté, s'adapter au Falstaff des deux
Henri IV, elle l'a pris dans une autre portion de sa vie et de son
caractère; et si on l'introduisait entre les deux parties de l'action qui se
continue dans les deux Henri IV, elle refroidirait l'imagination du
spectateur, au point de détruire entièrement l'effet de la seconde.
Bien que cette raison paraisse suffisante, on en pourrait trouver
plusieurs autres pour justifier l'opinion de Johnson. Ce n'est cependant
pas dans la chronologie qu'il faudrait les chercher. Ce serait une oeuvre
impraticable que de prétendre accorder ensemble les diverses données
chronologiques que, souvent dans la même pièce, il plaît à Shakspeare
d'établir; et il est aussi impossible de trouver chronologiquement la
place des Joyeuses Bourgeoises de Windsor entre Henri IV et Henri V,
qu'entre les deux parties de Henri IV. Mais, dans cette dernière
supposition, l'entrevue entre Shallow et Falstaff dans la seconde partie
de Henri IV, le plaisir qu'éprouve Shallow à revoir Falstaff après une si
longue séparation, la considération qu'il professe pour lui, et qui va
jusqu'à lui prêter mille livres sterling, deviennent des invraisemblances
choquantes: ce n'est pas après la comédie des Joyeuses Bourgeoises de
Windsor, que Shallow peut être attrapé par Falstaff. Nym, qu'on
retrouve dans Henri V, n'est point compté dans la seconde partie de
Henri IV, au nombre des gens de Falstaff. Il serait assez difficile, dans
les deux suppositions, de se rendre compte du personnage de Quickly,
si l'on ne supposait que c'est une autre Quickly un nom que Shakspeare
a trouvé bon de rendre commun à toutes les entremetteuses. Celle de
Henri IV est mariée; son nom n'est donc point un nom de fille; la
Quickly des Joyeuses Bourgeoises ne l'est pas.
Au reste, il serait superflu de chercher à établir d'une manière bien
solide l'ordre historique de ces trois pièces; Shakspeare lui-même n'y a
pas songé. On peut croire cependant que, dans l'incertitude qu'il a
laissée à cet égard, il a voulu du moins qu'il ne fût pas tout à fait
impossible de faire de ses Joyeuses Bourgeoises de Windsor la suite
des Henri IV. Pressé à ce qu'il paraît par les ordres d'Élisabeth, il n'avait
d'abord donné de cette comédie qu'une espèce d'ébauche qui fut
cependant représentée pendant assez longtemps, telle qu'on la trouve
dans les premières éditions de ses oeuvres, et qu'il n'a remise que
plusieurs années après sous la forme où nous la voyons maintenant.
Dans cette première pièce, Falstaff, au moment où il est dans la forêt,
effrayé des bruits qui se font entendre de tous côtés, se demande si ce
n'est pas ce libertin de prince de Galles qui vole les daims de son père.
Cette supposition a été supprimée dans la comédie mise sous la
seconde forme, lorsque le poëte voulut tâcher apparemment d'indiquer
un ordre de faits un peu plus vraisemblable. Dans cette même pièce
comme nous l'avons à présent, Page reproche à Fenton d'avoir été de la
société du prince de Galles et de Poins. Du moins n'en est-il plus, et
l'on peut supposer que le nom de Wild-Prince demeure encore pour
désigner ce qu'a été le prince de Galles et ce que n'est plus Henri V.
Quoi qu'il en soit, si la comédie des Joyeuses Bourgeoises offre un
genre de comique moins relevé que la première partie de Henri IV, elle
n'en est pas moins une des productions les plus divertissantes de cette
gaieté d'esprit dont Shakspeare a fait preuve dans plusieurs de ses
comédies.
Plusieurs nouvelles peuvent se disputer l'honneur d'avoir fourni à
Shakspeare le fond de l'aventure sur laquelle repose l'intrigue des
Joyeuses Bourgeoises de Windsor. C'est probablement aux mêmes
sources que Molière aura emprunté celle de son École des Femmes; ce
qui appartient à Shakspeare, c'est d'avoir fait servir la même intrigue à
punir à la fois le mari jaloux et l'amoureux insolent. Il a ainsi donné à
sa pièce, sauf la liberté de quelques expressions, une couleur beaucoup
plus morale que celle des récits où il a
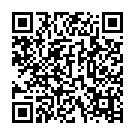
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



