ce double panache de
fumée qui se balance au faîte de leurs noires cheminées; voyez-vous
dans cette atmosphère imprégnée d'odeurs résineuses et aquatiques, ou
bien comptez ces boucauts de sucre, ces quarts[13] de farine, ces
barriques de tabac, ces caisses, ces ballots de toutes sortes amoncelés
sur les quais!
[Note 13: Les Canadiens-Français nomment ainsi les barils de farine,
provisions, etc.]
Partout l'activité, partout le travail intelligent, partout l'abondance.
Des hommes, des chevaux, des cabs, des cabrouets se pressent, se
froissent se heurtent. On dirait de l'entrepôt général du trafic du globe.
Mais laissons la rue des Commissaires où nous ramèneront
vraisemblablement les incidents de notre récit. En examinant Montréal
à vol d'oiseau, nous voyons la ville s'étager en amphithéâtre dans les
plis d'un terrain fortement tourmenté.
Les quartiers limitrophes du fleuve sont exclusivement consacrés aux
affaires. La majeure partie de la population y est anglaise. Plus loin, en
escaladant les premières rues de la montagne, nous rencontrons les rues
Craig, Vitré, de la Gauchetière, Dorchester, et la grande rue
Sainte-Catherine; plus loin encore, la rue Sherbrooke. Toutes observent
un parallélisme remarquable.
Les premières sont habitées par des Canadiens français, la dernière par
l'aristocratie anglaise.
Perdue sous des allées d'arbres touffus, la rue Sherbrooke ressemble
vraiment à l'avenue d'un Eden. Là on n'entend ni tumulte, ni grincement
criard. Le chant des oiseaux, les soupirs d'une romance, les
frémissements d'une harpe, le chuchotement d'un piano viennent
caresser vos oreilles.
Là, point de luxueux magasins pour fasciner vos yeux, mais des
cottages gracieux, des villas pimpantes, des manoirs féodaux en
miniature, de vertes pelouses, des jardins émaillés de fleurs pour
séduire votre imagination. Là, point de mouvement, point de passants
qui vous coudoient, mais le murmure harmonieux du feuillage, des
amants solitaires lentement pressés l'un contre l'autre, des apparitions
enchanteresses qui vous ravissent le coeur.
Elle n'est point régulière, la rue Sherbrooke, elle n'est point dallée, pas
même pavée, mais ses méandres sont si mystérieux, sa poussière est si
molle, son gazon si doux, ses ombrages si frais... Ah! oui, c'est bien
dans la rue Sherbrooke qu'on aime à aimer!
Et quel merveilleux panorama se déroule à vos pieds, se masse sur
votre tête! C'est Montréal, la vigilante, qui chauffe ses fourneaux, ouvre
ses chantiers, charge et décharge ses cargaisons, décore ses édifices,
agite ses milliers de bras, comme ses milliers de têtes! C'est une
montagne dont les sommets altiers déchirent la nue; ce sont de gras
coteaux, des bois plus verts que l'émeraude, des vergers où se veloutent
et se dorent les fruits savoureux, des parterres embaumés et diaprés de
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel.
L'extrémité septentrionale de la rue Sherbrooke aboutit à la rue
Saint-Denis, grande artère qui s'appuie perpendiculairement sur la rue
Notre Dame, divise toute la ville du haut en bas et court s'épanouir dans
la prairie.
Elle forme la limite du faubourg Québec.
Dans ce faubourg, un des plus populeux de Montréal, essaiment des
Canadiens-Français artisans, détailleurs ou débitants de boissons pour
la plupart. Jadis ses hôtes étaient gens enrichis par la traite des
pelleteries. On peut s'en convaincre aisément à l'apparence des maisons
que les désastreux incendies de 1852 ont épargnées[14].
[Note 14: Après ces incendies successifs, plus de vingt mille habitants
se trouvèrent sans logements.]
Mais, à mesure que la race anglaise s'est agglomérée dans la ville, elle
y a usurpé le sceptre de la fortune[15], et soit qu'elle ne voulût pas
s'allier à la race française, soit que ses goûts la portassent à se hausser,
elle a déserté les bords du fleuve pour charger de ses palais les gradins
de la montagne. On connaît l'histoire des moutons de Panurge: petit à
petit, les conquis ont imité les conquérants, et, à présent, sauf de rares
exceptions, il est peu de Canadiens-Français, rentiers ou dignitaires, qui
oseraient avouer un domicile dans le faubourg Québec.
[Note 15: Chose triste à dire, mais trop facile à comprendre, partout où
les populations protestante et catholique se trouvent en présence, on
voit la première prospérer, acquérir des richesses, l'autre décroître,
s'appauvrir.]
Cette migration n'a, du reste, rien qui doive surprendre. Les
circonstances ont pu les provoquer. Au fur et à mesure que la ville a
élargi sa ceinture, les fabriques, les usines se sont multipliées. Par
conséquent, les rives du fleuve ont acquis une importance relative
qu'elles n'avaient pas auparavant. On a vendu les terrains occupés par
les maisons de plaisance pour y faire des manufactures, et les premiers
se sont réfugiés autre part. Puis, fait digne d'attention, comme beaucoup
de cités américaines, Montréal tend à remonter le cours du fleuve qui
baigne ses murs. Il n'y a pas longtemps, les vaisseaux ne jetaient point
l'ancre plus haut que la place de la Douane. Par l'ouverture du canal
Lachine[16], on leur a facilité un mouillage jusqu'au bout de l'île, pour
ainsi dire. Dans
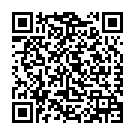
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



