reconnaissante. Toutes les villes qui
possédaient comme celles de Chypre un temple riche en courtisanes
avaient à l'égard de ces femmes les mêmes soins respectueux.
L'incomparable histoire de Phryné, telle qu'Athénée nous l'a transmise,
donnera quelque idée d'une telle vénération. Il n'est pas vrai
qu'Hypéride eut besoin de la mettre nue pour fléchir l'Aréopage, et
pourtant le crime était grand: elle avait assassiné. L'orateur ne déchira
que le haut de sa tunique et révéla seulement les seins. Et il supplia les
Juges « de ne pas mettre à mort la prêtresse et l'inspirée d'Aphroditê » .
Au contraire des autres courtisanes qui sortaient vêtues de cyclas
transparentes à travers lesquelles paraissaient tous les détails de leur
corps, Phryné avait coutume de s'envelopper même les cheveux dans
un de ces grands vêtements plissés dont les figurines de Tanagre nous
ont conservé la grâce. Nul, s'il n'était de ses amis, n'avait vu ses bras ni
ses épaules, et jamais elle ne se montrait dans la piscine des bains
publics. Mais un jour il se passa une chose extraordinaire. C'était le jour
des fêtes d'Eleusis, vingt mule personnes, venues de tous les pays de la
Grèce, étaient assemblées sur la plage, quand Phryné s'avança près des
vagues: elle ôta son vêtement, elle défit sa ceinture, elle ôta même sa
tunique de dessous, « elle déroula tous ses cheveux et elle entra dans la
mer ». Et dans cette foule il y avait Praxitèle qui d'après cette déesse
vivante dessina l'Aphroditê de Cnide; et Apelle qui entrevit la forme de
son Anadyomène. Peuple admirable, devant qui la Beauté pouvait
paraître nue sans exciter le rire ni la fausse honte!
Je voudrais que cette histoire fut celle de Bilitis, car, en traduisant ses
Chansons, je me suis pris à aimer l'amie de Mnasidika. Sans doute sa
vie fut tout aussi merveilleuse. Je regrette seulement qu'on n'en ait pas
parlé davantage et que les auteurs anciens, ceux du moins qui ont
survécu, soient si pauvres de renseignements sur sa personne.
Philodème, qui l'a pillée deux fois, ne mentionne pas même son nom. À
défaut de belles anecdotes, je prie qu'on veuille bien se contenter des
détails qu'elle nous donne elle-même sur sa vie de courtisane. Elle fut
courtisane, cela n'est pas niable; et même ses dernières chansons
prouvent que si elle avait les vertus de sa vocation, elle en avait aussi
les pires faiblesses. Mais je ne veux connaître que ses vertus. Elle était
pieuse, et même pratiquante. Elle demeura fidèle au temple, tant
qu'Aphroditê consentit à prolonger la jeunesse de sa plus pure
adoratrice. Le jour où elle cessa d'être aimée, elle cessa d'écrire, dit-elle.
Pourtant il est difficile d'admettre que les chansons de Pamphylie aient
été écrites à l'époque où elles ont été vécues. Comment une petite
bergère de montagnes eût-elle appris à scander ses vers selon les
rythmes difficiles de la tradition éolienne? On trouvera plus
vraisemblable que, devenue vieille, elle se plut à chanter pour
elle-même les souvenirs de sa lointaine enfance. Nous ne savons rien
sur cette dernière période de sa vie. Nous ne savons même pas à quel
âge elle mourut.
Son tombeau a été retrouvé par M. G. Heim à Palaeo-Limisso, sur le
bord d'une route antique, non loin des ruines d'Amathonte. Ces ruines
ont presque disparu depuis trente ans, et les pierres de la maison où
peut-être vécut Bilitis pavent aujourd'hui les quais de Port-Saïd. Mais le
tombeau était souterrain, selon la coutume phénicienne, et il avait
échappé même aux voleurs de trésors.
M. Heim y pénétra par un puits étroit comblé de terre, au fond duquel il
rencontra une porte murée qu'il fallut démolir. Le caveau spacieux et
bas, pavé de dalles de calcaire, avait quatre murs recouverts par des
plaques d'amphibolite noire, où étaient gravées en capitales primitives
toutes les chansons qu'on va lire, à part les trois épitaphes qui
décoraient le sarcophage.
C'était là que reposait l'amie de Mnasidika, dans un grand cercueil de
terre cuite, sous un couvercle modelé par un statuaire délicat qui avait
figuré dans l'argile le visage de la morte : les cheveux étaient peints en
noir, les yeux à demi fermés et prolongés au crayon comme si elle eût
été vivante, et la joue à peine attendrie par un sourire léger qui naissait
des lignes de la bouche. Rien ne dira jamais ce qu'étaient ces lèvres, à
la fois nettes et rebordées, molles et fines, unies l'une à l'autre, et
comme enivrées de se joindre. Les traits célèbres de Bilitis ont été
souvent reproduits par les artistes de l'Ionie, et le musée du Louvre
possède une terre cuite de Rhodes qui en est le plus parfait monument,
après le buste de Larnaka.
Quand on ouvrit la tombe, elle apparut dans l'état où une main pieuse
l'avait rangée, vingt-quatre siècles auparavant. Des fioles
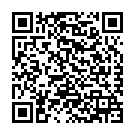
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



