guerrier d'une intrépidité rare.
Il est, en polémique, de l'école de Napoléon et des grands capitaines qui
savent qu'on ne se défend victorieusement qu'en prenant l'offensive et
que, se laisser attaquer, c'est être déjà à demi vaincu. Et il est venu
m'attaquer dans mon petit bois, au bord de mon onde pure. C'est un
rude assaillant. Il y va de l'ongle et des dents, sans compter les feintes
et les ruses. J'entends par là qu'en polémique il a diverses méthodes et
qu'il ne dédaigne point l'intuitive, quand la déductive ne suffit pas. Je
ne troublais point son eau. Mais il est contrariant et même un peu
querelleur. C'est le défaut des braves. Je l'aime beaucoup ainsi. N'est-ce
point Nicolas, son maître et le mien, qui a dit:
Achille déplairait moins bouillant et moins prompt.
J'ai beaucoup de désavantages s'il me faut absolument combattre M.
Brunetière. Je ne signalerai pas les inégalités trop certaines et qui
sautent aux yeux. J'en indiquerai seulement une qui est d'une nature
toute particulière; c'est que, tandis qu'il trouve ma critique fâcheuse, je
trouve la sienne excellente. Je suis par cela même réduit à cet état de
défensive qui, comme nous le disions tout à l'heure, est jugé mauvais
par tous les tacticiens. Je tiens en très haute estime les fortes
constructions critiques de M. Brunetière. J'admire la solidité des
matériaux et la grandeur du plan. Je viens de lire les leçons professées à
l'École normale par cet habile maître de conférences, sur l'Évolution de
la critique depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, et je n'éprouve
aucun déplaisir à dire très haut que les idées y sont conduites avec
beaucoup de méthode et mises dans un ordre heureux, imposant,
nouveau. Leur marche, pesante mais sûre, rappelle cette manoeuvre
fameuse des légionnaires s'avançant serrés l'un contre l'autre et couverts
de leurs boucliers, à l'assaut d'une ville. Cela se nommait faire la tortue,
et c'était formidable. Il se mêle, peut-être, quelque surprise à mon
admiration quand je vois où va cette armée d'idées. M. Ferdinand
Brunetière se propose d'appliquer à la critique littéraire les théories de
l'évolution. Et, si l'entreprise en elle-même semble intéressante et
louable, on n'a pas oublié l'énergie déployée récemment par le critique
de la Revue des Deux Mondes pour subordonner la science à la morale
et pour infirmer l'autorité de toute doctrine fondée sur les sciences
naturelles. C'était à l'occasion du Disciple et l'on sait si M. Brunetière
ménageait alors les remontrances à ceux qui prétendaient introduire les
théories transformistes dans quelque canton de la psychologie ou de la
sociologie. Il repoussait les idées darwiniennes au nom de la morale
immuable. «Ces idées, disait-il expressément, doivent être fausses,
puisqu'elles sont dangereuses.» Et maintenant, il fonde la critique
nouvelle sur l'hypothèse de l'évolution. «Notre projet, dit-il, n'est autre
que d'emprunter de Darwin et de Hæckel le secours que M. Taine a
emprunté de Geoffroy Saint-Hilaire et de Cuvier.» Je sais bien qu'autre
chose est de professer, comme M. Sixte, l'irresponsabilité des criminels
et l'indifférence absolue en matière de morale, autre chose est
d'appliquer aux genres littéraires les lois qui président à l'évolution des
espèces animales et végétales. Je ne dis pas du tout que M. Brunetière
se démente et se contredise. Je marque un trait de sa nature, un tour de
son caractère, qui est, avec beaucoup d'esprit de suite, de donner
volontiers dans l'inattendu et dans l'imprévu. On a dit, un jour, qu'il
était paradoxal, et il semblait bien que ce fût par antiphrase, tant sa
réputation de bon raisonneur était solidement établie. Mais on a vu à la
réflexion qu'il est, en effet, un peu paradoxal à sa manière. Il est
prodigieusement habile dans la démonstration: il faut qu'il démontre
toujours, et il aime parfois à soutenir fortement des opinions
extraordinaires et même stupéfiantes.
Par quel sort cruel devais-je aimer et admirer un critique qui correspond
si peu à mes sentiments! Pour M. Ferdinand Brunetière, il y a
simplement deux sortes de critiques, la subjective, qui est mauvaise et
l'objective, qui est bonne. Selon lui, M. Jules Lemaître, M. Paul
Desjardins, et moi-même, nous sommes atteints de subjectivité, et c'est
le pire des maux; car, de la subjectivité, on tombe dans l'illusion, dans
la sensualité et dans la concupiscence, et l'on juge les oeuvres humaines
par le plaisir qu'on en reçoit, ce qui est abominable. Car il ne faut pas se
plaire à quelque ouvrage d'esprit avant de savoir si l'on a raison de s'y
plaire; car, l'homme étant un animal raisonnable, il faut d'abord qu'il
raisonne; car il est nécessaire d'avoir raison et il n'est pas nécessaire de
trouver de l'agrément; car le propre de l'homme est de chercher à
s'instruire par le moyen de la dialectique, lequel est infaillible; car on
doit toujours mettre une vérité au bout d'un raisonnement, comme un
noeud
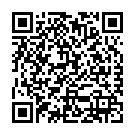
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



