l'analogie et le principe de continuité.
[Note 29: LEIBNIZ, Réplique aux réflexions de Bayle, p. 185.]
[Note 30: LEIBNIZ, Syst. nouv. de la nature, p. 124-125, 3.]
Le propre du Moi humain est d'envelopper «une multitude dans
l'unité[31]». Or telle est aussi la fonction essentielle de «ces forces
primitives» auxquelles on aboutit par l'analyse métaphysique de la
réalité. Elles doivent donc avoir, elles aussi, «quelque chose
d'analogique au sentiment et à l'appétit[32]». De plus, comme le monde
a pour auteur un être souverainement parfait, il faut qu'il soit le
meilleur possible; et, comme la bonté s'achève dans la beauté, il faut
aussi qu'il soit le plus beau possible. La nature est un poème immense
où tout varie par degrés insensibles et dans l'unité, où tout se tient et se
déploie dans la continuité. Or cette homogénéité fondamentale n'est pas
expliquée, si, comme l'a fait Descartes, on oppose radicalement
l'essence de l'esprit à l'essence de la matière. Il faut, pour la rendre
intelligible, se représenter l'univers entier comme la réalisation
différenciée à l'infini d'un seul et même principe qui est la pensée. Les
choses alors acquièrent «une simplicité surprenante, en sorte qu'on peut
dire que c'est partout et toujours la même chose, aux degrés de
perfection près[33]».
[Note 31: LEIBNIZ, Monadol., p.706, 14; Epist. ad Wagnerum, p. 466,
III.]
[Note 32: LEIBNIZ, Syst. nouv. de la nature, p. 124-125, 3.]
[Note 33: LEIBNIZ, Théod, p. 602, 337; N. Essais, p. 305.]
Le monde est donc plus qu'une machine. La machine est ce qu'on voit;
mais ce qu'on voit n'est qu'une apparence. Au fond, il y a l'être qui est
force, vie, pensée et désir. Le monde entier, y compris son Créateur, est
un système d'âmes qui ne diffèrent entre elles que par l'intensité de leur
action. En ce point capital, Leibniz ne contredit plus Aristote. Le grec
et l'allemand ont la même théorie. Pour l'un et pour l'autre, c'est l'amour
qui meut tout; et, par conséquent, l'un et l'autre admettent aussi la
prédominance des causes finales sur les causes efficientes. C'est le
finalisme qui l'emporte de nouveau. Ni Descartes, ni Hobbes, ni
Spinoza n'ont réussi à le détruire pour tout de bon.
Les agrégats corporels se composent de monades, c'est-à-dire de
principes simples dont l'essence consiste dans la perception. Et l'objet
de cette perception enveloppe toujours d'une certaine manière l'être tout
entier; car, les choses allant d'elles-mêmes au meilleur, il n'y a pas de
raison pour qu'il contienne telle portion de la réalité à l'exclusion de
telle autre[34].Chaque monade a quelque représentation de l'infini; et
c'est là qu'elle puise ses idées distinctes. Chaque monade, aussi, a
quelque représentation de l'univers; et c'est de là que lui viennent ses
idées confuses[35]. Les substances sont autant «de points de vue», d'où
l'on aperçoit d'une façon plus ou moins explicite et la nature immense
et l'Être éternel qui l'imprègne de toutes parts[36].
[Note 34: LEIBNIZ, Réplique aux réflexions de Bayle, p. 187b;
Monadol., p. 709b, 58, 60.]
[Note 35: LEIBNIZ, N. Essais, p. 222a, 1.]
[Note 36: LEIBNIZ, Monadol., p. 709b, 57; _Syst. nouv. de la nature,_
p. 126b, 11.]
Toutefois, cet Être éternel possède le privilège de n'avoir que des idées
distinctes: l'Infini seul est pensée pure[37].
[Note 37: LEIBNIZ, Epist. ad Wagnerum, p. 466b, IV; _Monadol.,
p.708a, 41.]
Quant aux autres monades, elles contiennent, avec «leur entéléchie
primitive», un obstacle également interne qui les entrave dans leur élan
vers la perfection[38].
[Note 38: LEIBNIZ, Théod., p. 510a, 20; Monadol., p. 708b, 47.]
Les anciens ont parlé de la matière seconde et de la _matière
première:_ et leur distinction n'est pas vaine, bien qu'il faille modifier
quelque peu leur manière de l'entendre. La matière seconde est d'ordre
phénoménal: elle vient toujours d'un agrégat de monades, mais elle
n'existe que dans la pensée et s'y traduit sous forme d'extension. Au
contraire, la matière première est d'ordre réel: c'est un principe que
chaque monade porte au-dedans d'elle-même, qui fait partie de son
essence, et dont l'effet naturel est de communiquer à ses perceptions de
provenance extérieure leur caractère extensif[39]. Mais l'étendu, c'est
aussi du confus[40]. Et, par conséquent, la matière première, voilà ce
qui limite l'action des substances créées; voilà ce qui les arrête, à des
étapes différentes, dans leur ascension vers la lumière des «idées
distinctes». «Autrement toute entéléchie serait Dieu[41].» Et de là une
hiérarchie infiniment variée d'êtres qui se ressemblent par leur fond.
Tout est pensée; mais la pensée dort dans le minéral et la plante,
sommeille dans l'animal, s'éveille en l'homme et trouve en Dieu son
éternel et plein achèvement. Encore y a-t-il, entre ces degrés divers, une
multitude incalculable et de différences et de nuances; car la nature ne
fait pas de bonds: c'est par un progrès insensible qu'elle passe du moins
au plus[42]. «Rien de stérile ou de négligé, rien de trop
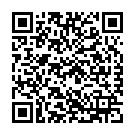
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



