déjà la révolution
qui devait amener leur indépendance.
La Virginie fut la première à s'opposer à la loi du timbre. A Boston la
population démolit les bureaux. Un congrès, composé des députes de la
plupart des Provinces, s'assembla à New-York et, protesta contre les
prétentions du gouvernement impérial. On brûla publiquement les
marchandises estampillées, et les négociants brisèrent leurs relations
commerciales avec l'Angleterre.
Effrayé, le gouvernement anglais révoqua cette malheureuse loi du
timbre qui provoquait d'aussi terribles colères.
L'abrogation de cette loi suspendit pendant quelque temps l'opposition
des provinces coloniales. Mais en 1773, le gouvernement anglais ayant
mis inconsidérément un nouvel impôt sur le thé, le feu de la révolte se
ralluma avec encore plus d'intensité qu'auparavant.
Le Parlement fut outré d'une récidive qui s'accentuait de plus, en plus,
et eut recours aux mesures coercitives pour faire rentrer dans le devoir
les colonies révoltées. D'un autre côté, pour s'attacher le Canada, il vota
le rétablissement des lois françaises en ce pays, y reconnut le
catholicisme comme religion établie, et donna à la province un Conseil
représentatif où les catholiques étaient admis à prendre place.
Cette loi souleva de vives réclamations en Angleterre, et surtout en
Amérique, où douze provinces protestèrent violemment, par la voix
d'un Congrès général siégeant à Philadelphie, contre cette loi de
Québec qui reconnaissait la religion catholique.
Protestation des plus inhabiles. En se déclarant contre les lois
françaises et contre le catholicisme, le congrès s'aliénait la population
du Canada qui devait être ainsi perdue à la cause de la confédération
depuis longtemps rêvée par Washington et Franklin.
Pourtant, par une singulière inconséquence, le même congrès adopta
une adresse aux Canadiens, où se trouvaient exprimés des sentiments
tout-à-fait contraires à ceux manifestés dans les premières résolutions.
Cette adresse fut assez froidement reçue au Canada, où la population,
satisfaite des récentes concessions du parlement impérial, n'avait qu'à
se défier des fallacieuses promesses cachées sous les belles phrases du
congrès. "Dans leur juste défiance," remarque M. Garneau, "la plupart
des meilleurs amis de la liberté restèrent indifférents ou refusèrent de
prendre part à la lutte qui commençait... Beaucoup d'autres Canadiens,
gagnés par la loi de 1774, promirent de rester fidèles à l'Angleterre et
tinrent parole. Ainsi une seule pensée de proscription mise au jour avec
légèreté; fut cause que les États-Unis voient aujourd'hui la dangereuse
puissance de leur ancienne métropole se consolider de plus en dans
l'Amérique du Nord."
Le général Carleton avait à peine eu le temps d'inaugurer au Canada la
nouvelle constitution, lorsque son attention fut attirée vers les frontières
que menaçaient déjà les Américains insurgés. Pendant que le colonel
Arnold s'avançait contre Québec par les rivières Kennebec et Chaudière,
mais lentement, retardé qu'il était dans sa marche par les obstacles sans
nombre que lui offrait la forêt vierge, le général Schuyler, nommé par
le Congrès au commandement de l'armée du Nord, marchait,
conjointement avec Montgomery, contre Montréal qui ne devait pas
tarder à succomber Aux premières nouvelles de l'invasion, le
gouverneur Carleton avait envoyé vers le lac Champlain le peu de
troupes dont il pouvait disposer, c'est-à-dire deux régiments qui
formaient huit cents hommes, tout ce qu'il y avait dans le pays. Comme
l'hiver approchait, il fallait renoncer à l'espoir d'en voir arriver d'autres
de l'Angleterre avant le retour du printemps.
Le gouvernement se vit donc forcée d'appeler la milice sous les ordres.
Si la majorité des Canadiens ne penchait pas du côté de la révolution,
son désir formel était bien aussi de ne se point mêler activement au
conflit et de garder la neutralité. La population resta sourde aux appels
réitérés de Carleton.
Alors celui-ci tenta de lever des corps de volontaires. Il offrit les
conditions les plus avantageuses. Mais ses offres firent peu de
prosélytes.
Aussi manquant de troupes, ne put-il secourir les forts de Chambly et
de Saint Jean qui se rendirent bientôt à l'ennemi.
A peine maître de Saint-Jean, Montgomery se porta sur Montréal.
Carleton Quitta précipitamment cette place où il se trouvait et
s'embarqua en toute hâte pour la capitale. Il ne parut qu'un: instant, et
en fugitif, aux Trois-Rivières, et continua sa retraite précipitée pour ne
s'arrêter qu'à Québec le 13 novembre 1775.
Pendant ce temps, Montréal et Trois-Rivières avaient ouvert leurs
portes aux insurgés, et Montgomery, qui suivait de près le gouverneur,
rejoignait le général Arnold. Celui-ci, après six semaines d'une marche
pénible, avait paru en face de Québec le jour même de l'arrivée du
gouverneur; mais comme il ne lui restait plus que six cent cinquante
hommes valides et qu'il ne pouvait songer attaquer Québec avec ce
petit nombre de combattants, il était remonte jusqu'à la
Pointe-aux-Trembles où il opéra sa jonction avec le général
Montgomery. Les deux corps réunis, mille ou douze cents soldats
environ, vinrent investir Québec. Mais n'anticipons point sur des
évènements dont nous allons maintenant exposer les
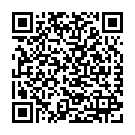
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



