grande donnée par la majorité de
l'Assemblée Nationale aux décrets du 4 août tendait à priver la ville de
Strasbourg de tous les droits et revenus régaliens de son petit territoire
et à bouleverser de fond en comble non seulement l'administration de
nos finances, mais encore son organisation judiciaire, ecclésiastique et
politique tout entière. Il ne pouvait convenir aux chefs nouveaux de la
cité, désignés par la confiance publique, de délaisser, sans effort pour le
sauver, le dépôt des franchises séculaires héritées de leurs pères. La
correspondance du Magistrat avec MM. Schwendt et de Türckheim,
nos députés à Versailles, nous montre en effet qu'ils ne faillirent point à
cette tâche. Le 1er octobre 1789 ils votèrent même une Déclaration de
la ville de Strasbourg à la Constituante, qu'on peut regarder comme les
dernières paroles de la "ci-devant République souveraine". Le
Magistrat y déclarait "renoncer avec empressement à tous ceux de ses
droits dont il croit le sacrifice utile à l'Etat", mais faire ses réserves les
plus claires et les plus précises au sujet des autres, et il demandait en
concluant que la "prospérité d'une des parties du territoire national ne
fût pas sacrifiée à l'apparence d'une amélioration et à un système
d'uniformité".
Ces doléances, qui donnèrent lieu, selon Schwendt, à "un peu de
murmure" quand on les résuma, selon l'usage parlementaire d'alors,
devant la Constituante, étaient assurément, à ce moment précis de notre
histoire locale, l'expression sincère de l'opinion professée par l'immense
majorité des bourgeois de la ville. Mais elles ne répondaient nullement,
par contre, aux sentiments du grand nombre des habitants non admis au
droit de bourgeoisie, qui formaient alors une partie notable de la société
strasbourgeoise. Cet élément, plus spécialement français de la
population, composé de fonctionnaires royaux, d'officiers, de
professeurs, d'artistes, de commerçants, n'avait rien à perdre et tout à
gagner à la chute définitive de l'ancien régime local. Ce n'était donc pas
une réforme, mais une révolution complète qu'il appelait de ses voeux.
Comme ce groupe comptait bon nombre d'esprits distingués, des
parleurs diserts, des hommes actifs et remuants, comme il répondait
d'ailleurs aux tendances du jour, il sut s'emparer peu à peu d'une partie
de l'opinion publique, grâce à la presse, grâce à la _Société des Amis de
la Révolution_, qu'il fonda d'abord à lui seul. Puis, gagnant des
adhérents chaque jour plus nombreux dans les couches populaires de
langue allemande, également tenues à l'écart et sans influence, il forma
comme une gauche militante à côté, puis en face de la masse plus
calme de la haute et moyenne bourgeoisie, libérale et conservatrice à la
fois.
Presque au même moment s'opérait une scission analogue eu sens
opposé. Parmi les grands propriétaires terriens, les princes étrangers
possessionnés en Alsace, qui venaient protester l'un après l'autre contre
une interprétation trop large des décrets du 4 août, il y avait un groupe
tout particulièrement menacé, le clergé, dont les biens avaient en
Alsace une étendue si considérable. Pour les seigneurs ecclésiastiques
la négation de leurs droits seigneuriaux n'était pas seulement une perte
grave, mais la ruine à peu près complète. Quand on regarde sur une
carte d'Alsace de ce temps l'étendue des territoires du prince-évêque de
Strasbourg et du prince-évêque de Spire, du Grand-Chapitre, des
abbayes de Marmoutier et de Neubourg, des chapitres de Murbach et de
Neuwiller, sans compter des seigneuries de moindre importance; on
comprend l'anxiété profonde qui travaillait le haut clergé de la province.
Il était évident, alors déjà, que la Constituante finirait par prendre une
décision radicale pour parer à la banqueroute, et que les biens du clergé
seraient employés à combler le gouffre béant, sauf à dédommager, le
plus modestement possible, les usufruitiers de ces immenses richesses.
Cette perspective, si tourmentante pour tout le clergé français, devait
particulièrement émouvoir le monde ecclésiastique d'Alsace.
A Strasbourg, où la présence d'une nombreuse population protestante
avait tenu de tout temps en éveil le sentiment catholique, où
d'incessantes immigrations, habilement favorisées, et des conversions
nombreuses avaient réussi à faire prédominer le culte romain, banni
jusqu'en 1681, sur l'ancienne bourgeoisie luthérienne, ces sentiments de
crainte et de mécontentement, faciles à comprendre, étaient partagés
par un grand nombre d'habitants. On n'a qu'à parcourir l'un des petits
Almanachs d'Alsace d'avant 1789, pour se rendre compte du grand
nombre de fonctionnaires judiciaires, financiers et ecclésiastiques,
attachés et vivant du clergé, qui se trouvaient alors à Strasbourg. Ils
avaient jusqu'ici laissé passer sans se révolter le mouvement politique
qui entraînait les esprits; quelques-uns même s'y étaient associés avec
un enthousiasme un peu naïf, mais assurément sincère. Mais quand ils
virent se dessiner à l'horizon ce qu'ils regardaient comme une spoliation
de l'Eglise, l'indifférence des uns, la sympathie des autres s'évanouirent.
Des sentiments hostiles commencèrent à se glisser dans les coeurs et à
y faire lever les premiers germes d'une dissidence que nous verrons
s'affirmer
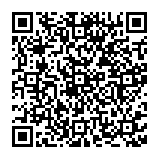
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



