à l'exil, et au bûcher s'il
reparaissait dans sa patrie.
Son existence pendant ces longues années d'exil est demeurée fort
obscure. On sait qu'il erra d'hospitalités en hospitalités, de châteaux en
châteaux, de couvens en couvens, «montant les escaliers des autres et
mangeant le pain d'autrui». On suit sa trace à Vérone, à Padoue, à
Sienne, à Bologne, à Crémone, près de tels ou tels personnages, de ces
tyrans qui se partageaient les provinces, les villes, les châteaux,
découpant chacun à leur tour cette malheureuse Italie dont le sort lui
arrachait de si éloquentes objurgations. On le suit encore à Paris, où son
séjour a été sans aucun doute contesté à tort.
Devenu Gibelin après son exil[4], il s'était uni d'abord à quelques
efforts pour rouvrir leur patrie à ses compagnons d'exil. C'est ainsi qu'il
aurait pris part en 1304 à une tentative armée des Gibelins exilés contre
la Florence Guelfe, et que plus tard il aurait voulu entraîner contre
Florence l'empereur Henri VII, Arrigo, descendu en Italie pour y
rétablir l'autorité de l'Empire. Mais il ne tarda pas à se séparer d'un parti
qui ne lui offrait que des sujets de dégoût ou des témoignages
d'impuissance.
Son existence se manifestait alors de temps à autre par des lettres, dont
un bien petit nombre sont parvenues jusqu'à nous, par des protestations
hautaines, par quelques interventions diplomatiques, par des
proclamations empreintes du plus ardent patriotisme envers cette Italie
qui existait encore à peine, mais dont les tronçons épars semblaient se
réunir dans son coeur par une secrète divination. Pendant ce temps, les
premiers fragmens de son grand poème commençaient à se répandre
dans la foule.
La vie qu'il menait alors se révèle à nous aujourd'hui par les oeuvres
que lui dictaient ce qu'on peut appeler ses idées fixes, c'est-à-dire la
constitution monarchique de la Société civile sous le sceptre de
l'Empire, à côté de la Société théocratique sous le pallium de la Papauté,
l'ennoblissement de la langue vulgaire de son pays, le redressement
d'une société confuse et dépravée, enfin la contemplation de la mort, à
laquelle nous devons la Divine Comédie.
De la première partie de sa vie, il ne nous reste à peu près aucune trace
qu'ait pu marquer l'attention ou le souvenir de ses contemporains. Il ne
nous reste que la Vita nuova qu'il nous a laissée et que l'on pense avoir
été composée en 1291 ou 1292, peut-être plus tard, mais certainement
avant 1300.
On ne peut y ajouter que quelques poésies légères, et les études
opiniâtres dont Il Convito nous fait la confidence.[5] Celles-ci doivent
avoir rempli surtout le temps écoulé entre la mort de Béatrice et son
accession au pouvoir.
C'est encore à cette époque de sa vie qu'appartient son mariage. Il s'est
toujours tu sur la place que cette union avait pu tenir dans son coeur ou
prendre à la direction de sa vie. Et le nom de Gemma Donati ne se
rattache plus au nom glorieux de Dante que par la progéniture qu'elle
lui a donnée.
II
J'ai pensé qu'il était à propos de rappeler les traits principaux de
l'existence du Poète de la Vita nuova. Ce n'est pas ici le lieu de
s'étendre sur ce sujet. Quant à ses différentes oeuvres comme de
Vulgari eloquio ou de Monarchia, il paraît assez difficile de leur
assigner une date, relativement en particulier à la Vita nuova, qui doit
seule nous occuper ici. Pour ce qui est de Il Convito, c'est une oeuvre
de longue haleine que M. Whitehead pense avoir été commencée avant
son priorat (1300), et continuée plus tard dans les jours d'exil.[6]
D'après ce que son auteur annonçait, on doit croire qu'il n'a pas été
terminé.
Je voudrais seulement essayer de reconstituer un peu la personnalité du
Poète durant la période qui correspond à sa passion pour Béatrice et
celle qui a suivi la mort de la Donna gentile. Nous ne possédons sur ce
sujet qu'un bien petit nombre de notions. Cependant il me semble
possible de s'en faire quelque idée qui ne soit pas trop éloignée de la
réalité.
La famille de Dante, dont il se plaît a faire remonter l'origine à des
temps très lointains, ne paraît avoir eu à Florence qu'une situation très
modeste.
Il perdit son père à l'âge de dix ans. Les Alighieri étaient sans doute
dans l'aisance. Dante possédait lui-même, lors de son priorat, plusieurs
propriétés, tant à Florence que dans les environs, dont nous ne
connaissons pas l'importance, et dont la confiscation accompagna sa
condamnation à l'exil. Et l'on pourrait dire, si cette expression était de
mise ici, qu'il appartenait à une bourgeoisie aisée.
Quant à la personne de son père, on n'en connaît rien. Et ce silence
absolu dans les souvenirs conservés de cette époque, comme dans
l'oeuvre de son fils, donne à penser qu'il ne tenait
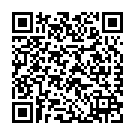
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



