partie de la latine.
Lorsqu'il sort de Port-Royal au mois d'octobre 1658, Jean Racine est à
la fois un adolescent très pieux,--et un adolescent fou de littérature.
Fou de littérature, il le serait peut-être devenu de lui-même. Mais il est
certain qu'il l'était aussi par la faute de ses vénérables maîtres.
Ses vénérables maîtres estimaient peu la littérature en elle-même. Pour
leur compte, ils ne visaient pas au talent. Ils jugeaient que ce qu'il
convient d'étudier chez les anciens et de leur emprunter, c'est
simplement l'art d'exprimer clairement et exactement sa pensée, afin
qu'elle soit plus efficace. Mais comment pouvaient-ils croire qu'un
enfant tendre, intelligent et passionné ne chercherait que cela dans
Homère, Sophocle, Euripide, Térence, Virgile? Est-ce par ces lectures
qu'ils pensaient le détourner de la poésie, ou le munir d'avance contre
les passions? Ces saints hommes goûtaient trop les belles-lettres. Ils
n'étaient pas parfaitement conséquents avec eux-mêmes, et je les en
aime davantage.--Il est bien probable, d'ailleurs, que les religieuses, et
sa tante la mère Agnès de Saint-Thècle, et sa grand'mère Marie
Desmoulins, avaient été touchées des strophes où l'enfant les comparait
à des «temples animés» et les appelait «astres vivants» (dame!
mettez-vous à leur place); qu'il leur avait montré sa traduction des
_Hymnes_ et qu'elles en avaient été émerveillées; et il est bien probable
aussi que ces «messieurs» n'avaient pu se tenir de louer les vers latins
que Racine avait adressés au Christ (_ad Christum_) pour le supplier de
défendre Port-Royal contre ses ennemis.
Ainsi, sans le savoir, Port-Royal poussait l'écolier vers la littérature et
la poésie,--et vers le théâtre, qui en était alors la forme la plus éclatante.
Port-Royal poussait Jean Racine à la damnation, jusqu'à l'heure où il
devait le ressaisir pour le salut; et il en résultera une vie des plus
tourmentées, des plus passionnées, des plus humaines par ses
contradictions intérieures. Sa vie même fut certainement, aux yeux de
Dieu, la plus belle de ses tragédies.
DEUXIÈME CONFÉRENCE
SES DÉBUTS.--SON SÉJOUR À UZÈS.--LES DEUX
TRADITIONS.
En octobre 1658, Racine, âgé de dix-huit ans et neuf mois, est mis au
collège d'Harcourt, à Paris, pour y faire une année de philosophie. Le
proviseur du collège, Pierre Baudet, et le principal, Fortin, étaient amis
des «solitaires.» Toutefois, dès cette année-là, le jeune homme
commence d'échapper à Port-Royal, et s'émancipe assez vivement.
Nous savons, par une de ses lettres, que, dans les premiers mois de
1660, il habite «à l'Image Saint-Louis, près de Sainte-Geneviève» (sans
doute quelque hôtel meublé) et qu'il est déjà lié avec le futile abbé Le
Vasseur, et avec son compatriote et un peu son parent (au 17e degré), le
doux bohème Jean de La Fontaine.
Puis, une lettre de septembre 1660 nous le montre établi à l'hôtel de
Luynes, quai des Grands-Augustins, chez son oncle à la mode de
Bretagne, Nicolas Vitart, intendant du duc de Luynes.
Ce Vitart, de quinze ans plus âgé que Racine, était, lui aussi, un ancien
élève de Port-Royal et, en particulier, du bon Lancelot. Mais il ne
semble pas avoir grandement profité d'une si sainte éducation. C'était
un galant homme, et assez mondain, un «honnête homme», au sens de
ce temps-là, nullement un chrétien austère. Il était sur un bon pied et
traité avec distinction chez les Luynes. D'ailleurs assez riche. Cet
intendant d'un grand seigneur était lui-même un petit seigneur, ayant
acheté de ses deniers divers fiefs et seigneuries.
Vitart s'occupait de littérature, surtout de vers galants et de théâtre. Il
fut, pour Racine, un tuteur fort peu gênant. Il lui ouvrait sa bourse au
besoin. Racine lui écrira d'Uzès en 1662: Je vous puis protester que je
ne suis pas ardent pour les bénéfices. (Il en attendait un de son oncle le
chanoine.) Je n'en souhaite que pour payer au moins quelque méchante
partie de tout ce que je vous dois.
Et la femme de Vitart aussi était charmante pour son jeune cousin. Elle
semble avoir été enjouée et fort peu prude. De quelques années plus
âgée que Jean Racine, elle le traitait avec une familiarité gentille, une
familiarité de jeune «marraine». Racine lui écrira d'Uzès, en 1661 et
1662, des lettres d'une galanterie respectueuse et tendre, semées de
petits vers. Il se plaint sans cesse qu'elle ne lui écrive pas assez:
J'irai, parmi les oliviers,
Les chênes verts et les figuiers,
Chercher
quelque remède à mon inquiétude.
Je chercherai la solitude
Et, ne
pouvant être avec vous,
Les lieux les plus affreux me seront les plus
doux.
Une fois il lui écrit (26 décembre 1661):
Et quand mes lettres seraient assez heureuses pour vous plaire, que me
sert cela? J'aimerais mieux _recevoir un soufflet ou un coup de poing
de vous, comme cela m'était assez ordinaire_, qu'un grand merci de si
loin.
Un coup de poing, un soufflet... Elle le traitait tout à fait en petit cousin.
Une autre fois
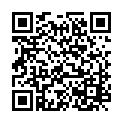
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



