les extravagances
qu'ils avaient achetées; et, feignant de croire que c'était là le peuple
français, ils semblaient leur dire: Que gagnerez-vous à secouer notre
joug? _Vous le voyez, les républicains ne valent pas mieux que
nous!_» Brissot, Danton, Hébert, figurent alternativement dans le
discours de Robespierre; et, pendant qu'il se livre contre ces prétendus
ennemis de la vertu aux déclamations de la haine, déclamations déjà
fort usées, il excite peu d'enthousiasme. Mais bientôt il abandonne cette
partie du sujet, et s'élève à des idées vraiment grandes et morales,
exprimées avec talent. Il obtient alors des acclamations universelles. Il
observe avec raison que ce n'est pas comme auteurs de systèmes que les
représentans[1] de la nation doivent poursuivre l'athéisme et proclamer
le déisme, mais comme des législateurs, cherchant quels sont les
principes les plus convenables à l'homme réuni en société. «Que vous
importent à vous, législateurs, s'écrie-t-il, que vous importent les
hypothèses diverses par lesquelles certains philosophes expliquent les
phénomènes de la nature? Vous pouvez abandonner tous ces objets à
leurs disputes éternelles; ce n'est ni comme métaphysiciens, ni comme
théologiens que vous devez les envisager: aux yeux du législateur, tout
ce qui est utile au monde et bon dans la pratique, est la vérité. L'idée de
l'Être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continuel à la
justice; elle est donc sociale et républicaine.... Qui donc t'a donné,
s'écrie encore Robespierre, la mission d'annoncer au peuple que la
Divinité n'existe pas? O toi qui te passionnes pour cette aride doctrine,
et qui ne te passionnas jamais pour la patrie! quel avantage trouves-tu à
persuader à l'homme qu'une force aveugle préside à ses destinées et
frappe au hasard le crime et la vertu? que son âme n'est qu'un souffle
léger qui s'éteint aux portes du tombeau? L'idée de son néant lui
inspirera-t-elle des sentimens[1] plus purs et plus élevés que celle de
son immortalité? Lui inspirera-t-elle plus de respect pour ses
semblables et pour lui-même, plus de dévouement pour la patrie, plus
d'audace à braver la tyrannie, plus de mépris pour la mort ou pour la
volupté? Vous, qui regrettez un ami vertueux, vous aimez à penser que
la plus belle partie de lui-même a échappé au trépas! Vous, qui pleurez
sur le cercueil d'un fils ou d'une épouse, êtes-vous consolé par celui qui
vous dit qu'il ne reste plus d'eux qu'une vile poussière? Malheureux qui
expirez sous les coups d'un assassin, votre dernier soupir est un appel à
la justice éternelle! L'innocence sur l'échafaud fait pâlir le tyran sur son
char de triomphe. Aurait-elle cet ascendant si le tombeau égalait
l'oppresseur et l'opprimé?...»
Robespierre, s'attachant toujours à saisir le côté politique de la question,
ajoute ces observations remarquables: «Prenons ici, dit-il, les leçons de
l'histoire. Remarquons, je vous prie, comment les hommes qui ont
influé sur la destinée des états furent déterminés vers l'un ou l'autre des
deux systèmes opposés, par leur caractère personnel, et par la nature
même de leurs vues politiques. Voyez-vous avec quel art profond César,
plaidant dans le sénat romain en faveur des complices de Catilina,
s'égare dans une digression contre le dogme de l'immortalité de l'âme,
tant ces idées lui paraissent propres à éteindre dans le coeur des juges
l'énergie de la vertu, tant la cause du crime lui paraît liée à celle de
l'athéisme! Cicéron, au contraire, invoquait contre les traîtres et le
glaive des lois et la foudre des dieux. Socrate mourant entretient ses
amis de l'immortalité de l'âme. Léonidas, aux Thermopyles, soupant
avec ses compagnons d'armes au moment d'exécuter le dessein le plus
héroïque que la vertu humaine ait jamais conçu, les invite pour le
lendemain à un autre banquet pour une vie nouvelle.... Caton ne
balança point entre Épicure et Zénon. Brutus et les illustres conjurés
qui partagèrent ses périls et sa gloire appartenaient aussi à cette secte
sublime des stoïciens, qui eut des idées si hautes de la dignité de
l'homme, qui poussa si loin l'enthousiasme de la vertu, et qui n'outra
que l'héroïsme. Le stoïcisme enfanta des émules de Brutus et de Caton
jusque dans les siècles affreux qui suivirent la perte de la liberté
romaine; le stoïcisme sauva l'honneur de la nature humaine, dégradée
par les vices des successeurs de César, et surtout par la patience des
peuples.»
Au sujet de l'athéisme, Robespierre s'explique d'une manière singulière
sur les encyclopédistes. «Cette secte, dit-il, en matière de politique,
resta toujours au-dessous des droits du peuple; en matière de morale
elle alla beaucoup au-delà de la destruction des préjugés religieux: ses
coryphées déclamaient quelquefois contre le despotisme, et ils étaient
pensionnés par les despotes; ils faisaient tantôt des livres contre la cour,
et tantôt des dédicaces aux rois, des discours pour les courtisans, et des
madrigaux pour les courtisanes; ils étaient fiers dans leurs écrits et
rampans[1] dans les antichambres.
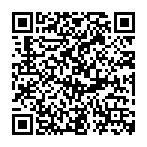
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



