les principes comme dans les faits. Sans doute,
les orages de la liberté existeront toujours, et il se commettra encore
bien des crimes en son nom: mais le fatalisme politique n'existe plus. Si
vous avez pu dire, dans votre temps, que le despotisme était un mal
nécessaire, vous ne le pourriez pas aujourd'hui, car, dans l'état actuel
des moeurs et des institutions politiques chez les principaux peuples de
l'Europe, le despotisme est devenu impossible.
MACHIAVEL.
Impossible?... Si vous parvenez à me prouver cela, je consens à faire un
pas dans le sens de vos idées.
MONTESQUIEU.
Je vais vous le prouver très-facilement, si vous voulez bien me suivre
encore.
MACHIAVEL.
Très-volontiers, mais prenez garde; je crois que vous vous engagez
beaucoup.
TROISIÈME DIALOGUE.
MONTESQUIEU.
Une masse épaisse d'ombres se dirige vers cette plage; la région où
nous sommes sera bientôt envahie. Venez de ce côté; sans cela, nous ne
tarderions pas à être séparés.
MACHIAVEL.
Je n'ai point trouvé dans vos dernières paroles la précision qui
caractérisait votre langage au commencement de notre entretien. Je
trouve que vous avez exagéré les conséquences des principes qui sont
renfermés dans l'Esprit des lois.
MONTESQUIEU.
J'ai évité à dessein, dans cet ouvrage, de faire de longues théories. Si
vous le connaissiez autrement que par ce qui vous en a été rapporté,
vous verriez que les développements particuliers que je vous donne ici
découlent sans effort des principes que j'ai posés. Au surplus, je ne fais
pas difficulté d'avouer que la connaissance que j'ai acquise des temps
nouveaux n'ait modifié ou complété quelques-unes de mes idées.
MACHIAVEL.
Comptez-vous sérieusement soutenir que le despotisme est
incompatible avec l'état politique des peuples de l'Europe?
MONTESQUIEU.
Je n'ai pas dit tous les peuples; mais je vous citerai, si vous voulez,
ceux chez qui le développement de la science politique a amené ce
grand résultat.
MACHIAVEL.
Quels sont ces peuples?
MONTESQUIEU.
L'Angleterre, la France, la Belgique, une portion de l'Italie, la Prusse, la
Suisse, la Confédération germanique, la Hollande, l'Autriche même,
c'est-à-dire, comme vous le voyez, presque toute la partie de l'Europe
sur laquelle s'étendait autrefois le monde romain.
MACHIAVEL.
Je connais un peu ce qui s'est passé en Europe depuis 1527 jusqu'au
temps actuel, et je vous avoue que je suis fort curieux de vous entendre
justifier votre proposition.
MONTESQUIEU.
Eh bien, écoutez-moi, et je parviendrai peut-être à vous convaincre. Ce
ne sont pas les hommes, ce sont les institutions qui assurent le règne de
la liberté et des bonnes moeurs dans les États. De la perfection ou de
l'imperfection des institutions dépend tout le bien, mais dépendra
nécessairement aussi tout le mal qui peut résulter pour les hommes de
leur réunion en société; et, quand je demande les meilleures institutions,
vous comprenez bien que, suivant le mot si beau de Solon, j'entends les
institutions les plus parfaites que les peuples puissent supporter. C'est
vous dire que je ne conçois pas pour eux des conditions d'existence
impossibles, et que par là je me sépare de ces déplorables réformateurs
qui prétendent construire les sociétés sur de pures hypothèses
rationnelles sans tenir compte du climat, des habitudes, des moeurs et
même des préjugés.
A l'origine des nations, les institutions sont ce qu'elles peuvent.
L'antiquité nous a montré des civilisations merveilleuses, des États dans
lesquels les conditions du gouvernement libre étaient admirablement
comprises. Les peuples de l'ère chrétienne ont eu plus de difficulté à
mettre leurs constitutions en harmonie avec le mouvement de la vie
politique; mais ils ont profité des enseignements de l'antiquité, et avec
des civilisations infiniment plus compliquées, ils sont cependant arrivés
à des résultats plus parfaits.
Une des causes premières de l'anarchie, comme du despotisme, a été
l'ignorance théorique et pratique dans laquelle les États de l'Europe ont
été pendant si longtemps sur les principes qui président à l'organisation
des pouvoirs. Comment, lorsque le principe de la souveraineté résidait
uniquement dans la personne du prince, le droit de la nation pouvait-il
être affirmé? Comment, lorsque celui qui était chargé de faire exécuter
les lois, était en même temps le législateur, sa puissance n'eût-elle pas
été tyrannique? Comment les citoyens pouvaient-ils être garantis contre
l'arbitraire, lorsque, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif étant déjà
confondus, le pouvoir judiciaire venait encore se réunir dans la même
main[2]?
Je sais bien que certaines libertés, que certains droits publics qui
s'introduisent tôt ou tard dans les moeurs politiques les moins avancées,
ne laissaient pas que d'apporter des obstacles à l'exercice illimité de la
royauté absolue; que, d'un autre côté, la crainte de faire crier le peuple,
l'esprit de douceur de certains rois, les portaient à user avec modération
des pouvoirs excessifs dont ils étaient investis; mais il n'en est pas
moins vrai que ces garanties si précaires étaient à la merci du monarque
qui possédait en principe les biens, les droits
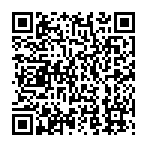
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



