longtemps avec la masse,
le besoin d'être seul ou avec le petit nombre... ce sera toujours sa vraie,
sa seule vertu.
Il sort de Paris le 15 juillet 1792 avec son frère le comte de
Chateaubriand. Ils avaient deux passeports pour Lille. Ils passent par
Tournay, par Bruxelles, «quartier général de la haute émigration», où
«les femmes les plus élégantes de Paris et les hommes les plus à la
mode, ceux qui ne pouvaient marcher que comme aides de camp,
attendaient dans les plaisirs les moments de la victoire»; il laisse son
frère à Bruxelles, traverse Liège, Aix-la-Chapelle, Cologne, Coblentz,
Trêves, où il rejoint l'armée des princes. L'ordre est de marcher sur
Thionville (où commande Wimpfen). L'armée royaliste y arrive le 1er
septembre.
«Auprès de notre camp indigent et obscur en existait un autre brillant et
riche. À l'état-major on ne voyait que fourgons remplis de comestibles;
on n'apercevait que cuisiniers, valets, aides de camp.» Le «camp
indigent et obscur» se composait de gentilshommes pauvres classés par
provinces et servant en qualité de simples soldats, qui détestent l'autre
camp, celui des élégants et des gentilshommes de cour. Ainsi, la partie
rurale et pauvre de l'armée des émigrés avait pour l'autre partie
quelques-uns des sentiments des révolutionnaires eux-mêmes. En
somme, cette armée ne semble pas avoir eu la foi.
Chateaubriand raconte tout cela fort gaiement. «Nous surgîmes
invaincus à Thionville, car chemin faisant nous ne rencontrâmes
personne.» Monsieur et le comte d'Artois se montrent, font la
reconnaissance de la place, somment en vain Wimpfen, et disparaissent.
Tout cela ne paraît pas très sérieux. On commence le siège, on fait
quelques travaux et quelques démonstrations, on reçoit quelques
bombes. On fait la cuisine, on lave son linge, on couche sous la tente.
La vie est un peu dure, mais fort convenable à des hobereaux chasseurs.
Derrière le camp s'est formée une espèce de marché ou de foire. Les
paysans amènent des quartauts de vin; on fait frire des saucisses et
sauter des crêpes. Des paysannes vendent du lait. On boit et on mange
ferme en racontant des histoires. «Cette vie de soldat, dit Chateaubriand,
est très amusante; je me croyais encore parmi les Indiens.»
Je ne pense pas que personne ait jamais plus clairement senti l'ironie et
la folie des choses, l'envers des grands sentiments et des grands
desseins, la misère des coulisses de l'histoire; ait tour à tour mieux
connu la joyeuse absurdité de tout, plus joui d'être vidé de toute
croyance et raillé plus sinistrement que le chevalier de Chateaubriand
devant Thionville. «Je me souviens d'avoir dit à mon camarade Ferron
que le roi périrait sur l'échafaud et que, vraisemblablement, notre
expédition devant Thionville serait un des principaux chefs
d'accusation contre Louis XVI.» Il avait donc, s'il faut l'en croire, le
sentiment de tuer allègrement son roi en mangeant des saucisses à la
foire, auprès du camp.
Mais, un jour que, recru de fatigue, il dormait presque sous les roues
des affûts où il était de garde, un obus lui envoya un éclat à la cuisse
droite. «Réveillé du coup, mais ne sentant point la douleur, je ne
m'aperçus de ma blessure qu'à mon sang. J'entourai ma cuisse de mon
mouchoir... Pendant ce temps-là, le sang coulait à torrents dans les
prisons de Paris: ma femme et mes soeurs étaient plus en danger que
moi.» Et voilà des émotions.
Quelques heures après, on lève le siège et l'on part pour Verdun. Sa
blessure ne lui permettant de marcher qu'avec douleur, Chateaubriand
se traîne comme il peut à la suite de sa compagnie, qui bientôt se
débande. Le plan du chevalier est de parvenir à Ostende et de
s'embarquer pour Jersey, où il trouvera son oncle Bédée. Tout cela avec
dix-huit livres tournois dans sa poche. Miné de fièvre, puis atteint d'une
«petite vérole confluente», boitillant sur sa béquille, ses cheveux
pendant sur son visage que masquent sa barbe et ses moustaches, la
cuisse entourée d'un torchis de foin, une couverture de laine par-dessus
son uniforme en loques; guettant sur les routes les charrettes des
paysans; couchant où il peut; de fossé en fossé, de grange en grange et
de charrette en charrette, il arrive à Namur, puis à Bruxelles où il
retrouve son frère et reçoit quelques soins; puis à Ostende par les
canaux; nolise avec quelques Bretons une barque pontée, couche dans
la cale sur des galets, fait relâche à Guernesey, où un prêtre émigré lui
lit les prières des agonisants et où le capitaine le fait débarquer sur le
quai pour qu'il ne meure pas à bord. (Tout cela, à ce qu'il raconte.) Mais
il rembarque le lendemain (car il a un tempérament de fer) et tombe
enfin, à Saint-Hélier, chez son oncle Bédée. Il y demeure quatre mois
entre la vie et la mort, et il apprend, dans son
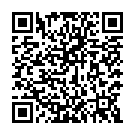
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



