trouver à la vie sauvage «tant de charme».) Et voici d'excellent
Bernardin de Saint-Pierre, avec peut-être quelque chose de plus vif
dans le pittoresque:
À quelque distance du rivage, à l'ombre d'un cyprès chauve, nous
remarquâmes de petites pyramides limoneuses qui s'élevaient sous l'eau
et montaient jusqu'à sa surface. Une légion de poissons d'or faisait en
silence les approches de la citadelle. Tout à coup l'eau bouillonnait; les
poissons d'or fuyaient. Des écrevisses armées de ciseaux, sortant de la
place insultée, culbutaient leurs brillants ennemis. Mais bientôt les
bandes éparses revenaient à la charge, faisaient plier à leur tour les
assiégés, et la brave mais lente garnison rentrait à reculons pour se
réparer dans la forteresse.
Ou bien:
De toutes les parties de la forêt, les chauves-souris accrochées aux
feuilles élèvent leur chant monotone: on croirait ouïr un glas continu.
Ou encore:
Les canards branchus, les linottes bleues, les cardinaux, les
chardonnerets pourpres brillent dans la verdure des arbres; l'oiseau
whet-shaw imite le bruit de la scie, l'oiseau-chat miaule, et les
perroquets qui apprennent quelques mots autour des maisons les
répètent dans les bois.
Déjà, pourtant, certaines inventions verbales et certaines harmonies
présagent, semble-t-il, le Chateaubriand futur:
Minuit. Le feu commence à s'éteindre, le cercle de sa lumière se rétrécit.
J'écoute: un calme formidable pèse sur ces forêts; on dirait que des
silences succèdent à des silences. Je cherche vainement à entendre dans
un tombeau universel quelque bruit qui décèle la vie. D'où vient ce
soupir? D'un de mes compagnons: il se plaint, bien qu'il sommeille. Tu
vis, donc tu souffres: voilà l'homme.
Ce n'est pas mal, pour un garçon de vingt-deux ans. Mais peut-être
a-t-il un peu arrangé cela pour l'édition de 1827. Avec lui, on ne sait
jamais.
Nous l'avons laissé au moment où il s'embarquait, pour le Havre. Il
nous dit que ce départ soudain fut le résultat d'un débat de conscience,
qu'il lui parut que c'était pour lui un devoir de revenir au secours du roi,
«quoique les Bourbons n'eussent pas besoin d'un cadet de Bretagne».
Mais, un peu plus loin, à l'heure de rejoindre l'armée des princes, il
prévoit toutes les objections qu'on peut lui faire et s'apprête à les réfuter,
fort posément et du ton d'un homme qui ne se fait point d'illusions.
Cela ne lui apparaissait donc pas, en tout cas, comme un devoir si
impérieux. Je crois que, tout simplement, il en avait assez de
l'Amérique, comme peut-être, lorsqu'il était parti pour l'Amérique, il en
avait assez de la France. C'était une âme invinciblement inquiète.
Un peu avant d'aborder à Saint-Malo, il est assailli par une terrible et
fort belle tempête, qui accroît son magasin de sensations et d'images.
Puis il s'en va à Saint-Malo et se marie.
Pourquoi? pourquoi? pourquoi? C'est affreusement simple. Il s'est
aperçu qu'il n'avait pas assez d'argent pour rejoindre les princes. «On
me maria, dit-il, afin de me procurer le moyen de m'aller faire tuer pour
une cause que je n'aimais pas.» Il épouse une orpheline, mademoiselle
Céleste Buisson de la Vigne, «blanche, délicate, mince et fort jolie»,
qu'il avait aperçue trois ou quatre fois, et dont «on estimait la fortune de
cinq à six cent mille francs». C'était donc un mariage riche. Mais il se
trouva que la fortune de sa femme était en rentes sur le clergé: «La
nation se chargea de les payer à sa façon...» Il faudra emprunter; un
notaire lui procurera dix mille francs. Au moment de partir, il les jouera,
et les perdra, sauf quinze cents francs. C'est avec ces quinze cents
francs qu'il partira pour l'armée des princes. Ce n'était pas la peine de
prendre femme pour cela... Il faut dire que c'est sa soeur Lucile qui l'a
voulu marier. Peut-être verrons-nous plus tard les raisons qu'elle en
avait.
À peine marié, il quitte sa jeune femme. Il l'oubliera totalement pendant
douze ans. Avant son départ, il revoit à Paris M. de Malesherbes et lui
soumet ses scrupules sur l'émigration. Car, dit-il, «mon peu de goût
pour la monarchie absolue ne me laissait aucune illusion sur le parti
que je prenais.» M. de Malesherbes répond à ses objections. «Il me cita
des exemples embarrassants. Il me présenta les Guelfes et les Gibelins
s'appuyant des troupes de l'empereur ou du pape; en Angleterre les
barons se soulevant contre Jean sans Terre; enfin, de nos jours, il citait
la république des États-Unis implorant le secours de la France.» Mais
Chateaubriand nous donne ensuite le vrai mobile de son acte: «Je ne
cédai réellement qu'au mouvement de mon âge, au point d'honneur.»
Deux décrets ayant déjà frappé les émigrés, «c'était dans ces rangs déjà
proscrits, dit-il, que j'accourais me placer... La menace du plus fort me
fait toujours passer du côté du plus faible». Là, il ne ment pas. L'orgueil,
l'impossibilité de «subir», l'impossibilité d'être
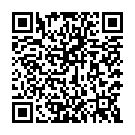
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



