les connaître, juge et dédaigne sans les comprendre. Même dans les cas où la
multiplication des faibles avantages personnels par l'amour-propre ne suffirait pas à
assurer à chacun la dose de bonheur, supérieure à celle accordée aux autres, qui lui est
nécessaire, l'envie est là pour combler la différence. Il est vrai que si l'envie s'exprime en
phrases dédaigneuses, il faut traduire: «Je ne veux pas le connaître» par «je ne peux pas
le connaître». C'est le sens intellectuel. Mais le sens passionné est bien: je ne veux pas le
connaître. On sait que cela n'est pas vrai mais on ne le dit pas cependant par simple
artifice, on le dit parce qu'on éprouve ainsi, et cela suffit pour supprimer la distance,
c'est-à-dire pour le bonheur.
L'égocentrisme permettant de la sorte à chaque humain de voir l'univers étagé au-dessous
de lui qui est roi, M. Bloch se donnait le luxe d'en être un impitoyable quand le matin en
prenant son chocolat, voyant la signature de Bergotte au bas d'un article dans le journal à
peine entr'ouvert, il lui accordait dédaigneusement une audience écourtée, prononçait sa
sentence, et s'octroyait le confortable plaisir de répéter entre chaque gorgée du breuvage
bouillant: «Ce Bergotte est devenu illisible. Ce que cet animal-là peut être embêtant. C'est
à se désabonner. Comme c'est emberlificoté, quelle tartine!» Et il reprenait une beurrée.
Cette importance illusoire de M. Bloch père était d'ailleurs étendue un peu au delà du
cercle de sa propre perception. D'abord ses enfants le considéraient comme un homme
supérieur. Les enfants ont toujours une tendance soit à déprécier, soit à exalter leurs
parents, et pour un bon fils, son père est toujours le meilleur des pères, en dehors même
de toutes raisons objectives de l'admirer. Or celles-ci ne manquaient pas absolument pour
M. Bloch, lequel était instruit, fin, affectueux pour les siens. Dans la famille la plus
proche, on se plaisait d'autant plus avec lui que si dans la «société», on juge les gens
d'après un étalon, d'ailleurs absurde, et selon des règles fausses mais fixes, par
comparaison avec la totalité des autres gens élégants, en revanche dans le morcellement
de la vie bourgeoise, les dîners, les soirées de famille tournent autour de personnes qu'on
déclare agréables, amusantes, et qui dans le monde ne tiendraient pas l'affiche deux soirs.
Enfin, dans ce milieu où les grandeurs factices de l'aristocratie n'existent pas, on les
remplace par des distinctions plus folles encore. C'est ainsi que pour sa famille et jusqu'à
un degré de parenté fort éloigné, une prétendue ressemblance dans la façon de porter la
moustache et dans le haut du nez faisait qu'on appelait M. Bloch un «faux duc d'Aumale».
(Dans le monde des «chasseurs» de cercle, l'un porte sa casquette de travers et sa vareuse
très serrée de manière à se donner l'air, croit-il, d'un officier étranger, n'est-il pas une
manière de personnage pour ses camarades?)
La ressemblance était des plus vagues, mais on eût dit que ce fût un titre. On répétait:
«Bloch? lequel? le duc d'Aumale?» Comme on dit: «La princesse Murat? laquelle? la
Reine (de Naples)?» Un certain nombre d'autres infimes indices achevaient de lui donner
aux yeux du cousinage une prétendue distinction. N'allant pas jusqu'à avoir une voiture,
M. Bloch louait à certains jours une victoria découverte à deux chevaux de la Compagnie
et traversait le Bois de Boulogne, mollement étendu de travers, deux doigts sur la tempe,
deux autres sous le menton et si les gens qui ne le connaissaient pas le trouvaient à cause
de cela «faiseur d'embarras», on était persuadé dans la famille que pour le chic, l'oncle
Salomon aurait pu en remontrer à Gramont-Caderousse. Il était de ces personnes qui
quand elles meurent et à cause d'une table commune avec le rédacteur en chef de cette
feuille, dans un restaurant des boulevards, sont qualifiés de physionomie bien connue des
Parisiens, par la Chronique mondaine du Radical. M. Bloch nous dit à Saint-Loup et à
moi que Bergotte savait si bien pourquoi lui M. Bloch ne le saluait pas que dès qu'il
l'apercevait au théâtre ou au cercle, il fuyait son regard. Saint-Loup rougit, car il réfléchit
que ce cercle ne pouvait pas être le Jockey dont son père avait été président. D'autre part
ce devait être un cercle relativement fermé, car M. Bloch avait dit que Bergotte n'y serait
plus reçu aujourd'hui. Aussi est-ce en tremblant de «sous-estimer l'adversaire» que
Saint-Loup demanda si ce cercle était le cercle de la rue Royale, lequel était jugé
«déclassant» par la famille de Saint-Loup et où il savait qu'étaient reçus certains israélites.
«Non, répondit M. Bloch d'un air négligent, fier et honteux, c'est un petit cercle, mais
beaucoup plus agréable, le cercle des ganaches. On y juge sévèrement la galerie.» «Est-ce
que sir Rufus Israël n'en est pas président», demanda Bloch fils
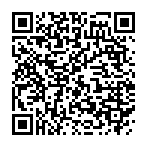
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



