Là s'ouvrait le gouffre destiné à contenir les organes de la machine à
roues. J'aperçus alors cet admirable engin de locomotion. Une
cinquantaine d'ouvriers étaient répartis sur les claires-voies métalliques
du bâti de fonte, les uns accrochés aux longs pistons inclinés sous des
angles divers, les autres suspendus aux bielles, ceux-ci ajustant
l'excentrique, ceux-là boulonnant, au moyen d'énormes clefs, les
coussinets des tourillons. Ce tronc de métal qui descendait lentement
par l'écoutille, c'était un nouvel arbre de couche destiné à transmettre
aux roues le mouvement des bielles. De cet abîme sortait un bruit
continu, fait de sons aigres et discordants.
Après avoir jeté un rapide coup d'oeil sur ces travaux d'ajustage, je
repris ma promenade et j'arrivai sur l'avant. Là, des tapissiers
achevaient de décorer un assez vaste roufle désigné sous le nom de
«smoking room», la chambre à fumer, le véritable estaminet de la ville
flottante, magnifique café éclairé par quatorze fenêtres, plafonné blanc
et or, et lambrissé de panneaux en citronnier. Puis, après avoir traversé
une sorte de petite place triangulaire que formait l'avant du pont,
j'atteignis l'étrave qui tombait d'aplomb à la surface des eaux.
De ce point extrême, me retournant, j'aperçus dans une déchirure des
brumes l'arrière du Great Eastern à une distance de plus de deux
hectomètres. Ce colosse mérite bien qu'on emploie de tels multiples
pour en évaluer les dimensions.
Je revins en suivant le boulevard de tribord, passant entre les roufles et
les pavois, évitant le choc des poulies qui se balançaient dans les airs et
le coup de fouet des manoeuvres que la brise cinglait çà et là, me
dégageant ici des heurts d'une grue volante, et, plus loin, des scories
enflammées qu'une forge lançait comme un bouquet d'artifice.
J'apercevais à peine le sommet des mâts, hauts de deux cents pieds, qui
se perdaient dans le brouillard, auquel les tenders de service et les
«charbonniers» mêlaient leur fumée noire. Après avoir dépassé la
grande écoutille de la machine à roues, je remarquai un «petit hôtel»
qui s'élevait sur ma gauche, puis la longue façade latérale d'un palais
surmonté d'une terrasse dont on fourbissait les garde-fous. Enfin
j'atteignis l'arrière du steamship, à l'endroit où s'élevait l'échafaudage
que j'ai déjà signalé. Là, entre le dernier roufle et le vaste caillebotis
au-dessus duquel se dressaient les quatre roues du gouvernail, des
mécaniciens achevaient d'installer une machine à vapeur. Cette
machine se composait de deux cylindres horizontaux et présentait un
système de pignons, de leviers, de déclics qui me sembla très
compliqué. Je n'en compris pas d'abord la destination, mais il me parut
qu'ici, comme partout, les préparatifs étaient loin d'être terminés.
Et maintenant, pourquoi ces retards, pourquoi tant d'aménagements
nouveaux à bord du Great Eastern, navire relativement neuf? C'est ce
qu'il faut dire en quelques mots.
Après une vingtaine de traversées entre l'Angleterre et l'Amérique, et
dont l'une fut marquée par des accidents très graves, l'exploitation du
Great Eastern avait été momentanément abandonnée. Cet immense
bateau disposé pour le transport des voyageurs ne semblait plus bon à
rien et se voyait mis au rebut par la race défiante des passagers
d'outre-mer. Lorsque les premières tentatives pour poser le câble sur
son plateau télégraphique eurent échoué -- insuccès dû en partie à
l'insuffisance des navires qui le transportaient --, les ingénieurs
songèrent au Great Eastern. Lui seul pouvait emmagasiner à son bord
ces trois mille quatre cents kilomètres de fil métallique, pesant quatre
mille cinq cents tonnes. Lui seul pouvait, grâce à sa parfaite
indifférence à la mer, dérouler et immerger cet immense grelin. Mais
pour arrimer ce câble dans les flancs du navire, il fallut des
aménagements particuliers. On fit sauter deux chaudières sur six et une
cheminée sur trois appartenant à la machine de l'hélice. À leur place, de
vastes récipients furent disposés pour y lover le câble qu'une nappe
d'eau préservait des altérations de l'air. Le fil passait ainsi de ces lacs
flottants à la mer sans subir le contact des couches atmosphériques.
L'opération de la pose du câble s'accomplit avec succès, et, le résultat
obtenu, le Great Eastern fut relégué de nouveau dans son coûteux
abandon. Survint alors l'Exposition universelle de 1867. Une
compagnie française, dite Société des Affréteurs du Great Eastern, à
responsabilité limitée, se fonda au capital de deux millions de francs,
dans l'intention d'employer le vaste navire au transport des visiteurs
transocéaniens. De là, nécessité de réapproprier le steamship à cette
destination, nécessité de combler les récipients et de rétablir les
chaudières, nécessité d'agrandir les salons que devaient habiter
plusieurs milliers de voyageurs et de construire ces roufles contenant
des salles à manger supplémentaires; enfin, aménagement de trois mille
lits dans les flancs de la gigantesque coque.
Le Great Eastern fut affrété au prix de vingt-cinq mille francs par mois.
Deux contrats furent passés avec G. Forrester & Co. de Liverpool:
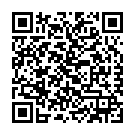
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



