sous une forme attrayante et à la portée de tous les esprits.
Tout Canadien aimera à lire Une fête de Noël sous Jacques Cartier et
en retirera, sans aucun doute, de grands avantages.
Le style de cet ouvrage m'a paru élégant, facile, plein de chaleur et de
mouvement, propre à en assurer le succès dans toutes les classes de la
société.
Veuillez agréer, Monsieur le Surintendant, l'hommage de mon sincère
et respectueux dévouement.
L. N. BÉGIN, Ptre.
ARGUMENT ANALYTIQUE
---
PROLOGUE
UN CAUSEUR D'AUTREFOIS.
Le 24 Décembre 1885, à Québec, l'auteur d'Une Fête de Noël sous
Jacques Cartier rencontre, sur la Grande Allée, le personnage de
Laverdière.--La conversation s'engage et l'archéologue en profite pour
donner libre essor aux souvenirs historiques de sa puissante
mémoire.--Ce que lui rappelaient en particulier le chiffre trois, le
nombre treize et la journée du vendredi.--Quelle ville regardait
Laverdière. Carillons de Noël.--Une cloche absente.--Pourquoi la foule
accourait à Notre-Dame.
CHAPITRE I
LA NEF-GÉNÉRALE: "Grande Hermine."
Laverdière propose à son compagnon de route d'entrer à l'église... et le
transporte, à 350 ans de distance, au minuit du 25 Décembre 1535.--La
Forêt de Donnacona.--Ancienne topographie historique.--Ce qu'on peut
voir dans un profil de rivière.--Les trois vaisseaux de Jacques
Cartier.--Une chambre de batterie dans La Grande Hermine.--Office
divin: Dom Guillaume Le Breton, le premier des aumôniers de Jacques
Cartier pontifie en présence du Capitaine Découvreur, des officiers de
la flottille et de tout le personnel valide des trois équipages.--Etude sur
les noms inscrits au rôle d'équipage.--Le décor de la
Nef-Générale.--Les trois voilures des navires identifiées par
Laverdière.--Notre-Dame de Roc-Amadour.--Adeste fideles.--Foi
ardente du Découvreur.
CHAPITRE II
LA CARAVELLE; "Petite Hermine"
Un vaisseau-hôpital.--Les scorbutiques de la flottille.--Dom
Anthoine.--Le récit d'Yvon LeGal.--Les prières de la Nativité.--Ce que
chante la Liturgie Catholique dans l Province de Québec.--Hymnes
d'église; leurs paraphrases historiques.--Les sonneries de la Petit
Hermine.
CHAPITRE III
LA GALIOTE: "Emérillon".
Les deux promeneurs quittent le vaisseau-hôpital, jettent un coup d'oeil
sur le Fort Jacques Cartier, et se rendent à l'embouchure du ruisseau
Saint-Michel.--Ils y découvrent l'Emérillon enlisé dans la neige.--Le
cadavre du premier scorbutique, Philippe Rougemont, a été déposé à
bord de la galiote. Eustache Grossin, compagnon marinier, Guillaume
Séquart et Jehan Duvert, charpentiers du navire, font auprès du cercueil
de leur camarade la veillée des morts.--Causeries des matelots. Que
deviendra Stadaconé? La bourgade sera-t-elle grande ville? Et la
montagne, comme le rocher de Saint-Malo, aura-t-elle une ceinture de
remparts crénelés, des murailles, des tours, une citadelle pour
diadème?--La mémoire de Jacques Cartier sera-t-elle
immortelle?--Adieux à Rougemont.--Les dernières prières.
CHAPITRE IV
UN NOËL BRETON.
Réflexions de Laverdière sur les Noëls de la Nouvelle-France.--Ce que
les gars de Saint-Malo pensaient des aurores boréales.--Qui les aurait
bien expliquées.--La bûche de Noël--Feu de joie.--Invocations de
Jacques Cartier.
ÉPILOGUE
Comment s'en alla Laverdière.--Et ce qu'il advint des trois vaisseaux de
Jacques Cartier.
UNE FÊTE DE NOËL SOUS JACQUES CARTIER
======================
CHAPITRE PREMIER
---
PROLOGUE
---
UN CAUSEUR D'AUTREFOIS
---
L'un de vos amis, me disait Laverdière, quelque littérateur à
imagination brillante, écrira sans doute merveilles sur "Québec en l'an
2,000". Que prouvera son succès? Pour l'avoir traité avec un éclatant
mérite, ce sujet en demeurera-t-il moins léger, capricieux, fantaisiste? Il
me rappelle, par sa facilité d'exécution, ces dentelles amusantes, ces
broderies au crochet, que l'on peut, à loisir, commencer, continuer,
abandonner, reprendre ou terminer sans compter les mailles ou les
points, ni même regarder aux dessins du patron.
C'est le genre préféré des talents faciles et paresseux. Pas d'études pour
ceux-là, pas de recherches ardues, pas de contraintes historiques ou
d'obstacles d'archéologie; il leur suffit de s'abandonner à la dérive, à la
grâce du style et de l'imagination, au fil de la plume... le fil de l'eau,
l'aval de la rivière. Et le tour est fait.
Mais, pour les vaillants du travail intellectuel, pour les archivistes, les
chroniqueurs, les historiens, pour ceux-là qui remontent les rapides à la
perche, refoulent les courants à coups d'aviron, font les portages longs
et pénibles, reprennent enfin les explorations d'avant-garde hardiment
risqués par les pionniers de la civilisation chrétienne, sur une route
encore lumineuse, après trois cents ans, du passage de la gloire
catholique française,--pour ceux-là, ce n'est pas le Québec chimérique
et fantaisiste du vingtième siècle qu'ils cherchent, mais le Québec des
âges héroïques, celui du 31 Décembre 1775, ou celui du 13 Septembre
1759; le Québec provoquant et fier du 16 Octobre 1690, ou le Québec
affolé des nuits d'Octobre 1660; le Québec puritain du 20 Juillet 1629,
avec le drapeau anglais flottant aux tourelles du Château St. Louis, ou
le Kébec Fondé du 3 juillet 1608, le Kébecq se Samuel de Champlain,
ou bien encore, ou bien enfin le Stadaconé de Donnacona, la sauvage et
primitive capitale d'un royaume barbare, la bourgade algonquine,
l'amas de cabanes indiennes blotties, come des poussins, sous une aile
d'oiseau, [4] le Canada[5]
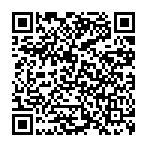
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



