Boson, roi de Provence, par
l'impératrice Richilde, soeur de Richard, neveu de Charles le Chauve,
et, par sa mère Adélaïde, neveu du roi de Bourgogne jurane Rodolphe
1er[20].
Suivant une légende accréditée postérieurement, il aurait été tenu sur
les fonts baptismaux par le roi Charles le Simple lui-même[21]; mais
Charles, étant né en 879, ne devait pas être beaucoup plus âgé que son
prétendu filleul. Ce dernier est, en effet, déjà témoin dans un acte de
901, et l'on sait que les exemples de témoins au-dessous de douze ans
sont exceptionnels[22].
Raoul avait une soeur, Ermenjart, qui épousa Gilbert de Dijon[23], et
deux frères cadets, Hugues le Noir et Boson qui, comme lui, ne
jouèrent aucun rôle politique actif du vivant de leur père[24]. Leur trace
ne se retrouve que dans les souscriptions de chartes. C'est, semble-t-il,
Raoul qui souscrit un arrêt de Richard relatif à Saint-Bénigne de Dijon,
datant des dix dernières années du IXe siècle; en tout cas c'est bien lui
qui figure dans un acte de Richard en faveur de l'abbaye de
Montiéramey, du 21 décembre 901, où il est qualifié de «fils de
Richard»[25]. Peut-être aussi est-ce lui et son frère Boson qui signent
une donation de l'impératrice Richilde à l'abbaye de Gorze[26]. Les
trois frères sont témoins dans une charte de concession octroyée par
Richard à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon[27] et paraissent remplir
un rôle moins effacé au tribunal comtal d'après une charte en faveur de
l'église d'Autun rédigée et scellée au nom de Raoul, agissant comme
mandataire de son père (Pouilly, 5 septembre 916)[28]. Raoul
intervient aussi dans un acte délivré en 918 par l'évêque d'Autun,
Walon, avec l'assentiment du duc de Bourgogne[29].
Les fils de Richard portèrent simultanément le titre de comte. Après la
mort de son père, Raoul continue à s'intituler de même, ainsi qu'on le
voit dans une charte de donation de sa mère Adélaïde, relative à des
biens sis en Varais (Autun, 24 avril 922)[30]
Des premiers actes de Raoul comme duc de Bourgogne, on ne connaît
guère que la prise de Bourges[31]. Mais il règne beaucoup d'obscurité
sur les circonstances qui accompagnèrent cet événement. On trouve
mentionné: en 916 un incendie de Bourges, en 918 une prise de
possession éphémère de la ville par Guillaume, neveu de Guillaume Ier
d'Aquitaine, et en 924 une cession de la ville et du Berry par Raoul,
devenu roi, à Guillaume, moyennant l'hommage[32]. Le duc de France
Robert avait, paraît-il, aidé Raoul à s'emparer de Bourges, mais on ne
saurait décider si ce fut en 916 ou entre 916 et 918, ou encore plus tard.
Raoul s'était en effet allié à la puissante famille des ducs de France,
suzeraine de tout le pays au nord de la Loire, en épousant la propre fille
de Robert, Emma, princesse douée d'une rare intelligence et d'une mâle
énergie[33].
Charles le Simple témoignait aussi des égards à Raoul en souvenir de
son père, dont il avait â maintes reprises éprouvé le loyalisme. Il
semble même qu'en prescrivant à l'abbé de Saint-Martial de Limoges,
Étienne (élu en 920), d'élever deux fortes tours pour résister à
Guillaume d'Aquitaine, il prenait ouvertement le parti de Raoul[34].
Robert l'emporta néanmoins, car dans sa lutte contre Charles, nous
voyons Hugues le Noir, frère du roi Raoul, lui amener des recrues
bourguignonnes pour coopérer avec les forces des grands vassaux à la
lutte contre les troupes royales. Toutefois, après l'armistice intervenu à
la fin de l'année 922, les Bourguignons s'étaient définitivement
retirés[35].
Pour bien comprendre leur rentrée en scène et finalement l'élection de
Raoul comme roi, il est nécessaire de jeter un coup d'oeil rapide en
arrière et de se rappeler l'état politique de la France à cette époque,
ainsi que les principaux événements qui venaient de marquer le règne
de Charles le Simple.
FOOTNOTES:
[Footnote 9: Favre, Eudes, p. 78, 95-96, 147, 156, 161, 165, 192.]
[Footnote 10: _Ann. Vedast._, a. 898.]
[Footnote 11: Il l'appelle son «très cher» (_admodum dilectus_), son
«très fidèle», le «conseil et l'auxiliaire de son royaume» (_regni et
consilium et juvamen_). Pélicier, _Cartul. du chapitre de l'église
cathédrale de Châlons-sur-Marne_, p. 31; Recueil des historiens de
France, IX, 523, 536.]
[Footnote 12: _Ann. Vedast._, a. 900.]
[Footnote 13: Recueil des historiens de France, IX, p. 495-499.]
[Footnote 14: Ibid., p. 499. Eckel, p.68.]
[Footnote 15: _Cartul. de Saint-Père de Chartres_, éd. B. Guérard
(Paris, 1840), I, p. 46-47.]
[Footnote 16: Dudon de Saint-Quentin, De moribus, I. II, c. 30.]
[Footnote 17: Flod., Ann., a. 921: «... Britanniam ipsis [Normannis],
quam vastaverant, cum Namnetico pago concessit [Rotbertus].» Cf.
Dudon de Saint-Quentin, éd. Lair, p. 69, n. 4.]
[Footnote 18: Voy. Favre, Eudes, p. 12; Eckel, Charles le Simple, p. 34;
F. Lot, _Études sur le règne de Hugues Capet_ (Paris, 1903, in-8), p.
187.]
[Footnote 19: _Ann. Vedast._,
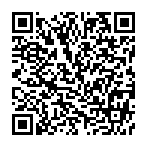
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



