le choix des sujets, dans le style, dans la
versification, a déployé 'une véritable originalité dans l'idylle.'
[Footnote 10: Journal des Savants, article sur les oeuvres complètes
d'André Chénier par Raynouard, 1819.]
Style incorrect, parfois barbare, idées vagues et incohérentes, manie de
mutiler la phrase et de la tailler à la grecque, coupes bizarres, prononce
Victor Hugo[11]. 'Chacun de ces défauts du poète, ajoute-t-il, est
peut-être le germe d'un perfectionnement pour la poésie.' Victor Hugo
voit dans l'oeuvre de Chénier une poésie nouvelle. Il y trouve même
fraîcheur d'idées, même luxe d'images que dans Lamartine.
[Footnote 11: _Littérature et philosophie mêlées_, par Victor Hugo,
édition ne varietur_, Hetzel-Quantin, 1882--t. i: Sur André de Chénier_
(1819); _Sur un poète apparu en 1820_--c'est-à-dire Lamartine (1820).]
On voit donc que les premiers critiques d'André Chénier reconnaissent
en lui un novateur et que, même, leurs habitudes sont vivement
heurtées par ses innovations.
En 1828--après une nouvelle édition[12], augmentée de quelques
morceaux inédits, mais qui altère souvent le texte,--c'est encore la
nouveauté de l'oeuvre que constate Villemain[13]. Chénier a 'une
manière neuve de sentir et de rendre l'antiquité.' Il a fait pour la poésie
ce que Bernardin de Saint-Pierre avait fait pour la prose; il lui a rendu
le coloris par la simplicité.
[Footnote 12: OEUVRES POSTHUMES D'ANDRÉ CHÉNIER,
édition nouvelle publiée par D. Charles Robert, Paris, Guillaume,
1824-26, 2 volumes avec un facsimilé.]
[Footnote 13: _Tableau de la Littérature du XVIIIe siècle_, par
Villemain (1828), 3e édition, Didier, 1841 (tome iv, leçons 58, 59, 60).]
En cette même année Sainte-Beuve, dans son _Tableau de la Poésie
française au XVIe siècle_[14], donne André Chénier, avec les hommes
de la Pléiade: Ronsard, Du Bellay, etc., comme ancêtre aux
romantiques. André Chénier ouvre une époque[15]. Il a retrempé le
vers flasque du XVIIIe siècle. Son alexandrin n'est celui ni de Racine ni
de Delille, mais celui de Ronsard, de Baïf et de Régnier[16].
Sainte-Beuve se passionne pour André Chénier. Il ne cesse plus de
s'occuper de lui. Après les fragments inédits donnés par H. de
Latouche[17] et sa nouvelle édition[18], Sainte-Beuve lui-même publie
de nouveaux fragments[19], insérés dans l'édition clichée de 1839[20];
il entreprend de corriger les éditions de H. de Latouche, se met en
rapport avec Gabriel de Chénier (fils de Sauveur Chénier) et publie une
importante étude sur André Chénier[21], où, examinant l'_Hermès_ et
corrigeant son impression première, il prononce que celui qu'il
revendiquait naguère comme un précurseur du romantisme était 'un
homme aussi pleinement et chaudement de son siècle à sa manière que
pouvait l'être Raynal ou Diderot.'
[Footnote 14: _Tableau de la poésie française au seizième siècle_, par
Sainte-Beuve, 1828.]
[Footnote 15: _Mathurin Régnier et André Chénier_, par Sainte-Beuve
(août 1829), dans _Portraits Littéraires_, tome i, pp. 159-75.]
[Footnote 16: _Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme_, par
Sainte-Beuve, 1829.]
[Footnote 17: FRAGMENTS D'ANDRÉ CHÉNIER, publiés par H. de
Latouche dans la Revue de Paris, décembre 1829, mars 1830.]
[Footnote 18: ANDRÉ CHÉNIER, POÉSIES POSTHUMES ET
INÉDITES publiées par H. de Latouche, Paris, Charpentier et Randuel,
1833, 2 vol. _Revue des Deux Mondes_, 15 juin 1838, article de G.
Planche.]
[Footnote 19: FRAGMENTS DE CHÉNIER, publiés par Sainte-Beuve
dans la Revue des Deux Mondes, 1er février 1839, sous le titre
_Quelques documents inédits sur André Chénier_.]
[Footnote 20: POÉSIES D'ANDRÉ, précédées d'une notice par M.
Henri de Latouche, suivie de notes et fragments, etc. Nouvelle édition.
Paris, Charpentier, 1839.]
[Footnote 21: _Portraits littéraires_, par Sainte-Beuve, t. i, pp. 176-208
(1er février 1839). OEUVRES EN PROSE D'ANDRÉ CHÉNIER,
_augmentées d'un grand nombre de morceaux inédits et précédées de
toutes les relatives à son procès devant le tribunal révolutionnaire_...
Paris, Ch. Gosselin, 1840.]
André Chénier, que l'on vient de voir revendiquer un moment comme
ancêtre du romantisme, sera plus tard proclamé précurseur de l'École
parnassienne. Il est donc curieux d'enregistrer l'appréciation que fit de
lui en 1840 le jeune Leconte de Lisle[22]: 'La facture de son vers, la
coupe de sa phrase pittoresque et énergique, ont fait de ses poèmes une
oeuvre nouvelle et savante d'une mélodie entièrement ignorée, d'un
éclat inattendu.'
[Footnote 22: _André Chénier_, par Leconte de Lisle, article publié
dans la _Variété_, Rennes, 1840-41.
_Poésies de François Malherbe avec un_ COMMENTAIRE _inédit
par_ ANDRÉ CHÉNIER, publiées par M. de Latour, Paris, Charpentier,
1842.]
En avançant dans cette revue de la critique qu'a provoquée l'oeuvre
d'André Chénier, il semble qu'on s'enfonce dans un fourré d'opinions
contradictoires. Voici Saint-Marc Girardin[23] pour qui rien, chez
André Chénier, ne laisse prévoir le romantisme, et qui, tout en
déclarant, avec une apparente contradiction, que sa poésie annonce
Lamartine, lui attribue une mélancolie uniquement littéraire. Voici
Nisard[24] pour qui André Chénier ne fut point de son temps et a égalé
ses maîtres antiques.
[Footnote 23: _Cours de littérature dramatique_, par Saint-Marc
Girardin, Paris, Charpentier, 1843, 5 volumes in-12°(t. IV, ch. liv).]
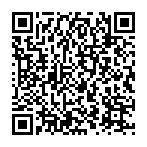
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



