cayda.
Les personnes habituées au commerce ou à l'emploi des laines
reconnaissent au coup d'oeil leur degré de finesse. Il en est qui s'en
assurent en étendant les filamens sur une étoffe noire et les regardant à
la loupe. Mais Daubenton qui, comme on sait, s'est occupé d'une
manière spéciale de l'éducation des bêtes à laine, a conseillé aux
manufacturiers de soumettre ces filamens de laine à un micromètre
placé dans un microscope. Ce micromètre, dit M. Tessier, représentait
un petit réseau ou un composé de mailles. Il n'y avait qu'un 10e de ligne
entre les deux côtés parallèles des carrés du micromètre dont se servait
M. Daubenton, et sa lentille grossissait quatorze fois. Ayant reconnu,
par des observations soigneusement faites, que les gros filamens[2] de
vingt-neuf échantillons de laine superfine, apportés de diverses
manufactures, occupaient rarement plus des deux carrés du micromètre,
il a fixé le dernier terme des laines superfines à celles dont les plus gros
filamens remplissent par leur largeur un carré du micromètre, et dont le
diamètre est la 70e partie d'une ligne. La largeur des plus gros filamens
de la laine la plus grossière occupait jusqu'à six carrés du micromètre,
qui équivalent à la 23e partie d'une ligne. 5 Les plus gros filamens du
jarre remplissaient jusqu'à onze carrés du micromètre, qui font 1712 de
ligne. Un pareil examen est presque impraticable par les bergers, dont
l'oeil et l'habitude suffisent pour cette opération. Nous ajouterons que
sans recourir au micromètre de Daubenton, on peut fort aisément
s'assurer du degré de finesse des laines au moyen du microscope
d'Amici ou d'Euler, perfectionné par MM. Vincent Chevalier et fils.
[Note 2: Toutes les laines sont composées de fils très fins, et de plus ou
moins gros. Ces derniers, d'après l'observation de Daubenton, se
trouvent au bout des mèches.]
L'état de santé de l'animal et l'époque de la tonte influent
singulièrement sur la bonté et la beauté des laines. Ainsi les animaux
malades non seulement perdent une partie de leur laine, mais l'autre
manquant de nourriture est sèche et se détache aisément de la peau. Il
en est de même de celle qu'on extrait de ces animaux qui ont succombé.
Quant à celle provenant des peaux des moutons tués pour la boucherie,
ces laines s'éloignent d'autant plus de leur point de maturité que ces
animaux ont été égorgés à une époque plus ou moins rapprochée de
celle de leur tonte. Il manque à ces laines ce moelleux que leur
communique le suint et qui les nourrit; si l'on ajoute à cela la chaux ou
les cendres qu'on emploie pour les détacher de la peau, on se rendra
compte de leur rudesse. Quant aux peaux à laine longue, les bouchers
les font tondre en toison.
Il est donc bien évident que l'époque la meilleure pour couper les laines
est celle où elles sont en pleine maturité. On ne doit pas dépasser ce
point parce qu'en France les animaux, surtout ceux qui sont faibles, en
perdent une partie[3]. Si on les tond, au 6 contraire, avant cette maturité,
les filamens semblent adhérer entre eux par leur base, et la laine est,
comme on dit, tendre, c'est-à-dire qu'elle manque de nerf ou de force.
[Note 3: Il n'en est pas de même des mérinos; ceux-ci, hors les cas de
maladie, peuvent conserver leur laine jusqu'à trois ans, presque sans en
perdre. Tessier, Nouveau Cours complet d'agriculture.]
Dans le midi de la France on tond les laines de la mi-mai au 15 juin;
dans les autres départemens, dans tout ce dernier mois. Il est une raison
qui doit engager les propriétaires à ne pas dépasser cette époque, c'est
qu'alors les chaleurs survenant, les toisons, outre leur poids,
interceptent la transpiration, échauffent l'animal et permettent à la
vermine de s'y fixer, etc.
Le volume et le poids des toisons est relatif à la taille de l'animal, à son
espèce et au climat sous lequel il vit, indépendamment des soins et de
la nourriture plus ou moins abondante qu'on lui donne. Nous allons
faire connaître, par aperçu, le poids de la plupart des laines connues, tel
que M. Tessier l'a donné.
1º La toison des moutons alençons, ardennois et de la Sologne, pèse de
deux à quatre livres. Cette dernière laine est entre-mêlée de poils roux
et est impropre à la chapellerie. On en fait des couvertures.
2º Celle des moutons briards, bourbonnais, champenois et de Langres,
pèse également de deux à quatre livres; elle est employée pour la
bonneterie, et très peu propre à la chapellerie.
3º Celle des moutons du Bar pèse trois livres. La première qualité sert
pour la bonneterie et à faire des ratines.
4º Celle des moutons de Faux, Valières ou Bocagers, pèse de trois à
quatre livres. La plus grande partie de ces laines est mêlée de blanc, de
noir
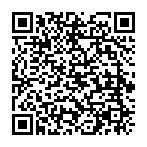
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



