maison de campagne, à
Courbevoie; assis près de lui à table, nous causâmes des études, des
méthodes d'enseignement, des lettres classiques et modernes, vivement,
librement, comme d'anciennes connaissances et presque comme des
compagnons de travail. La conversation tomba sur les poëtes latins et
leurs commentateurs; je parlai avec éloge de la grande édition de
Virgile par Heyne, le célèbre professeur de l'Université de Goettingue,
et du mérite de ses dissertations. M. de Fontanes attaqua brusquement
les savants allemands; selon lui, ils n'avaient rien découvert, rien ajouté
aux anciens commentaires, et Heyne n'en savait pas plus, sur Virgile et
sur l'antiquité, que le père La Rue. Il était plein d'humeur contre la
littérature allemande en général, philosophes, poëtes, historiens ou
philologues, et décidé à ne pas les croire dignes de son attention. Je les
défendis avec la confiance de ma conviction et de ma jeunesse, et M. de
Fontanes, se tournant vers son autre voisin, lui dit en souriant: «Ces
protestants, on ne les fait jamais céder.» Mais loin de m'en vouloir de
mon obstination, il se plaisait évidemment au contraire dans la
franchise de ce petit débat. Sa tolérance pour mon indépendance fut
mise un peu plus tard à une plus délicate épreuve. Quand j'eus à
commencer mon cours, en décembre 1812, il me parla de mon discours
d'ouverture et m'insinua que j'y devrais mettre une ou deux phrases à
l'éloge de l'Empereur; c'était l'usage, me dit-il, surtout à la création
d'une chaire nouvelle, et l'Empereur se faisait quelquefois rendre
compte par lui de ces séances. Je m'en défendis; je ne voyais à cela, lui
dis-je, point de convenance générale; j'avais à faire uniquement de la
science devant un public d'étudiants; je ne pouvais être obligé d'y mêler
de la politique, et de la politique contre mon opinion: «Faites comme
vous voudrez, me dit M. de Fontanes, avec un mélange visible d'estime
et d'embarras; si on se plaint de vous, on s'en prendra à moi; je nous
défendrai, vous et moi, comme je pourrai[3].»
[Note 3: Malgré ses imperfections, que personne ne sentira plus que
moi, on ne lira peut-être pas sans quelque intérêt ce discours, ma
première leçon d'histoire et ma première parole publique, et qui est
resté enfoui dans les archives de la Faculté des lettres, depuis le jour où
il y fut prononcé, il y a quarante-cinq ans. Je le joins aux _Pièces
historiques_ (n° III).]
Il faisait acte de clairvoyance et de bon sens autant que d'esprit
généreux en renonçant si vite et de si bonne grâce à l'exigence qu'il
m'avait témoignée. Pour le maître qu'il servait, l'opposition de la société
où je vivais n'avait point d'importance pratique ni prochaine; c'était une
pure opposition de pensée et de conversation, sans dessein précis, sans
passion efficace, grave pour la longue vue du philosophe, mais
indifférente à l'action du politique, et disposée à se contenter longtemps
de l'indépendance des idées et des paroles dans l'inaction de la vie.
En entrant dans l'Université, je me trouvai en contact avec une autre
opposition, moins apparente, mais plus sérieuse sans être, pour le
moment, plus active. M. Royer-Collard, alors professeur d'histoire de la
philosophie et doyen de la Faculté des lettres, me prit en prompte et
vive amitié. Nous ne nous connaissions pas auparavant; j'étais
beaucoup plus jeune que lui; il vivait loin du monde, n'entretenant
qu'un petit nombre de relations intimes; nous fûmes nouveaux et
attrayants l'un pour l'autre. C'était un homme, non pas de l'ancien
régime, mais de l'ancien temps, que la Révolution avait développé sans
le dominer, et qui la jugeait avec une sévère indépendance, principes,
actes et personnes, sans déserter sa cause primitive et nationale. Esprit
admirablement libre et élevé avec un ferme bon sens, plus original
qu'inventif, plus profond qu'étendu, plus capable de mener loin une idée
que d'en combiner plusieurs, trop préoccupé de lui-même, mais
singulièrement puissant sur les autres par la gravité impérieuse de sa
raison et par son habileté à répandre, sur des formes un peu solennelles,
l'éclat imprévu d'une imagination forte excitée par des impressions
très-vives. Avant d'être appelé à enseigner la philosophie, il n'en avait
pas fait une étude spéciale, ni le but principal de ses travaux, et dans
nos vicissitudes politiques de 1789 à 1814, il n'avait jamais joué un rôle
important, ni hautement épousé aucun parti. Mais il avait reçu dans sa
jeunesse, sous l'influence des traditions de Port-Royal, une forte
éducation classique et chrétienne; et après la Terreur, sous le régime du
Directoire, il était entré dans le petit comité royaliste qui correspondait
avec Louis XVIII, non pour conspirer, mais pour éclairer ce prince sur
le véritable état du pays, et lui donner des conseils aussi bons pour la
France que pour la maison de Bourbon, si la maison de Bourbon et la
France devaient se retrouver un jour. Il
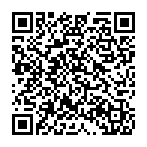
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



