fameux «Ave,
Caesar morituri te salutant», César, ceux qui vont mourir te saluent. Le
rétiaire jetait son vaste filet sur le mirmillon armé d'une courte épée.
Des gladiateurs à cheval, ou montés sur des chars, s'entretuaient dans
les cirques. Des galères se heurtaient dans les naumachies. Puis ce
furent les massacres en grand, des combats de bêtes féroces, des
centaines de captifs égorgés ou livrés aux lions, aux panthères, aux ours,
des supplices raffinés, des repas de chair humaine sur les arènes,
arrosées d'eau de senteur, et aux acclamations d'une foule délirante.
Cette férocité indiquait la complète décadence des sports; quelques
particuliers se livraient au jeu de paume, à la gymnastique; mais l'idéal
grec semblait perdu.
=Les sports en France.=--L'ancienne Gaule connut des jeux assez
brutaux; les Gaulois prenaient plaisir aux combats singuliers. On vit
Pépin le Bref, roi des Francs, entrer dans une arène, où luttaient un lion
et un taureau et les abattre de son épée. Le roi n'est-il pas d'ailleurs, aux
termes du «Roman de la Rose», «le plus ossu, le plus corsu?»
Pendant tout le Moyen-Age, il fallait que chacun fût en mesure de
défendre sa vie, continuellement menacée. On se souciait alors fort peu
de l'instruction, abandonnée aux seuls moines; il ne s'agissait que d'être
fort, le plus fort. Aussi les nobles consacraient-ils la plus grande partie
de leur temps à manier l'épée à une ou à deux mains, la lance, la masse
d'arme, tandis que le peuple s'exerçait à l'arbalète, à l'arc, à la
hallebarde, à l'épieu.
La chevalerie adoucit les jeux et les transforma en divertissements
luxueux, chantés par les trouvères et troubadours. Les tournois
mettaient en valeur la grâce et la vaillance des seigneurs; ceux-ci
étaient encouragés par la présence des dames dont ils portaient
fréquemment un gage sur leurs armures; il arrivait qu'un adversaire
s'emparât de ces gages qui pouvaient être renouvelés. On raconte
qu'après un tournoi «les dames s'en allaient les cheveux sur leurs
épaules et leur cotte sans manches, car toutes avaient donné aux
chevaliers pour les parer, et guimpes et chaperons, manteaux et camises,
manches et habits»; lorsqu'elles s'en aperçurent «elles en furent comme
toutes honteuses, mais sitôt qu'elles virent que chacun était dans le
même état, elles se mirent toutes à rire de leur aventure».
Le jeu de paume était très en faveur dans toutes les classes de la société.
«Au XIVe siècle[1] tout bon Français prenait de l'ébat, c'est-à-dire se
livrait au sport en plein champ ou à huis-clos.» On pratiquait alors la
lutte; et les jeux de la soule, de la crosse, du mail.
La Renaissance fit prédominer la culture intellectuelle sur la culture
physique; les siècles qui suivirent amenèrent la décadence des jeux, à
l'exception des jeux de hasard et des carrousels.
Pendant le XIXe siècle, on s'est livré à l'équitation, au canotage, à la
gymnastique. Mais ce n'est guère que depuis une trentaine d'années que,
las de la supériorité anglo-saxonne, on s'est décidé, en France, à faire
du sport d'une façon consciente et rationnelle.
[Note 1: J.-J. Jusserand. Sports de l'ancienne France.]
SPORTS ATHLÉTIQUES
=I.--LES JEUX DE LA BALLE=
Les jeux de la balle remontent à la plus haute antiquité: Homère dans
son odyssée, nous montre Nausicaa, fille de roi, jouant à la balle avec
ses compagnes. Les Grecs englobaient divers exercices avec le ballon
sous le nom de «sphéristique». Les Romains jouaient à la «pila». De
nos jours, la balle est la reine du sport.
=Le football.=--Le football (de l'anglais foot, pied, ball, ballon) est de
tous les sports à la mode le plus répandu et celui qui développe au
mieux les qualités morales de décision, d'énergie et de sang-froid. Il
convient à tous les hommes jeunes et n'exige pas de ses fervents le
surmenage physique qu'imposent certains exercices athlétiques. On ne
saurait trouver pour la jeunesse de divertissement plus sain; c'est ce qui
explique, mieux que toute autre raison, son succès rapide en France.
Ses origines sont assez obscures; on le rattache au «follis» des Latins.
Plus près de nous, on lui retrouve dans l'ancienne France une parenté
indéniable avec la «soule» bretonne et la «barrette» du Centre. Il est
fort probable quoique les Anglais ne veuillent pas le reconnaître, que le
football, sport national anglais, n'est qu'un dérivé de ces jeux français
qui, d'ailleurs, furent interdits par des ordonnances royales, à cause de
leur brutalité et disparurent peu à peu de nos provinces.
Jusqu'au XIXe siècle, la plus grande confusion préside dans les
règlements qui régissent les football des écoles anglaises. Ce n'est
qu'après 1850 qu'on essaya d'unifier les règles multiples et l'on se
trouva alors en présence des partisans irréductibles de deux méthodes
différentes: celle de Rugby, permettant l'usage des mains et celle de
l'école d'Eton qui n'autorisait l'usage que des pieds. Ces deux formes de
football se sont maintenues
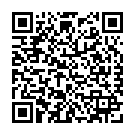
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



