l'Autriche, vaillamment menée et où il avait payé
largement de sa personne, rectifiait à son profit les frontières de
l'Alfanie. Son peuple l'adorait. Par sa sévère économie et sa scrupuleuse
application aux affaires, le royaume prospérait. Les ressources
naturelles du sol étaient, pour la première fois, sérieusement exploitées,
et l'industrie se développait avec une sorte de soudaineté et dans des
proportions surprenantes. Mais alors un fait singulier se produisait.
Dans ce royaume protégé auparavant contre la contagion
révolutionnaire par sa situation géographique et où l'institution de la
monarchie absolue s'était jusque-là conservée intacte, la rapidité du
progrès industriel avait ce résultat inattendu que la question sociale s'y
trouvait posée avant même la question politique. Désaccoutumés de la
pauvreté et de la résignation, les ouvriers de la capitale et ceux des
grandes villes, peu à peu, se désaffectionnaient du roi et le rendaient
responsable de l'iniquité de leur condition, bien qu'ils lui fussent
redevables de l'état déjà meilleur qui leur permettait de ressentir plus
vivement cette iniquité. Des grèves terribles avaient éclaté, que le roi
avait réprimées rudement, en homme habitué à ne point douter de son
droit et à ne point trembler devant son devoir...
Et, ainsi, après un labeur de cinquante ans, il se voyait méconnu de
ceux pour qui il avait tant travaillé, haï des uns, suspect aux autres,
respecté encore des nobles et des riches, mais désormais considéré par
eux comme également incapable, à cause de son grand âge, soit de
résister au mal par la force, soit d'y porter remède par d'apparentes
concessions aux «idées nouvelles». Bref, il n'était plus, pour les uns,
qu'un tyran et, pour les autres, qu'un «vieux».
C'est cela, plus encore que les infirmités et la maladie, qui l'avait décidé
à déléguer ses pouvoirs à son fils aîné. Hermann passait pour libéral; la
foule l'aimait et attendait de lui les «réformes» réclamées. Ce fils, dont
il ne pouvait s'empêcher d'estimer l'honnêteté et la vertu, avait toujours
désolé le roi Christian par l'étrangeté de sa conduite et de ses idées, de
celles du moins qu'il laissait pressentir: taciturne, secret, épris de
solitude, étranger aux choses militaires, ennemi de tout faste et de tout
appareil, mélancolique, toujours dans les livres... Nulle pensée
commune entre lui et sa femme, cette fière princesse Wilhelmine, très
«vieux régime», archiduchesse dans l'âme énergique et sereine et avec
qui le vieux roi se sentait en conformité de principes et de croyances. Si
seulement elle avait pu avoir quelque influence sur son mari! Mais,
depuis longtemps, Hermann, enfermé dans ses rêveries, l'avait
découragée par sa douceur entêtée et silencieuse. Et c'était à ce fils dont
il était si peu sûr que le vieillard se voyait contraint de confier le dépôt
de sa royauté. Ah! le mystérieux et inquiétant dépositaire!
Trouvait-il, du moins, quelque consolation dans son autre fils? Une
brute, ce prince Otto: perdu de vices, criblé de dettes, l'hôte et l'obligé
de tous les barons israélites, à Paris la moitié du temps, un prince de
boulevard et de restaurants de nuit.
Quant au prince Renaud, le neveu du roi, orphelin dès l'enfance
(comme on meurt dans ces vieilles familles royales!) et qui s'était élevé
tout seul, qu'attendre de ce fou, de ce bohème, qui ne paraissait pas une
fois par an à la cour, qui vivait de pair à compagnon avec des artistes,
des poètes et des journalistes et qui affichait publiquement le dédain, ou
mieux l'ignorance, de sa naissance et de son rang?
Et c'était là toute la maison royale! Car fallait-il compter le fils
d'Hermann, le petit prince Wilhelm, un enfant de cinq ans, chétif,
névropathe déjà, toujours malade et qui, sans doute, ne vivrait pas?
Pourtant, sa mère était saine et robuste, et son père avait eu une
jeunesse chaste. Qu'est-ce donc qu'il expiait, cet innocent? La folie
sanglante de son ancêtre Christian XI ou la folie érotique de sa
trisaïeule la reine Ortrude? Ou bien payait-il le surmenage physique et
moral, le labeur surhumain d'une si longue lignée de princes
administrateurs et soldats, raidis toute leur vie dans une attitude et dans
un effort ininterrompus et presque tous morts à la tâche? Ou bien
plusieurs siècles de mariages entre consanguins ou de mariages
purement politiques, mal assortis et sans amour, n'avaient-ils laissé
enfin, dans les veines du dernier des Marbourg, qu'un sang corrompu et
décoloré?
Pauvre race de rois! A mesure que son sang s'appauvrissait, son âme
aussi semblait défaillir... Au reste, c'était ainsi dans toute l'Europe: chez
la plupart des membres des familles régnantes se trahissait une
diminution de la foi et de la vertu royale, une lassitude, un
désenchantement ou une terreur de régner. Ils semblaient gênés d'être à
part; on devinait en eux un désir inavoué de revenir à la vie normale, à
la vie de tout le monde, comme si l'isolement de leur
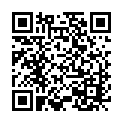
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



