succès; qu'après avoir quitté les rubans verts
de l'homme aux haines vigoureuses, il ait presque aussitôt reparu sous
la casaque jaune et vert du jovial fagotier. Molière voulut sans doute
s'amuser lui-même, Lucullus soupa chez Lucullus. Après la satire
sociale et l'éloquence austère d'Alceste, voici la haute bouffonnerie, la
gaieté jaillissante et intarissable, la verve folle, le sel gaulois lancé à
pleines mains. Molière est bien ici le fils de Rabelais.
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI est de toutes ses pièces la plus
franchement, la plus continûment et la plus irrésistiblement gaie; elle
guérirait l'hypocondrie la plus sombre. C'est une cure de rire, qu'il faut
ordonner aux mélancoliques. Car Molière est un grand médecin, il
possède la panacée universelle, et peut à bon droit s'écrier ici comme
l'opérateur de ses intermèdes:
O grande puissance de l'orviétan!
Aussi est-ce de toutes les farces de Molière la plus populaire et la plus
répandue. Je l'ai vue, dans mon enfance, représentée par des
marionnettes de campagne, devant un auditoire de paysans qui ne
l'avaient et ne l'auraient certainement jamais lue. Ils n'y cherchaient pas
malice, et s'en donnaient à coeur joie, sans se soucier de l'origine
probable de l'oeuvre, non plus que du nom de l'auteur.
Ne pouvant imiter leur sagesse, rappelons que LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI fut représenté pour la première fois, sur le théâtre du
Palais-Royal, le vendredi 6 août 1666, deux mois après la première du
MISANTHROPE, dont le succès commençait à se ralentir au bout de
21 représentations. On le donna, comme «petite pièce», à la suite de LA
MÈRE COQUETTE, du FAVORI, des FACHEUX puis avec LE
MISANTHROPE, qu'il accompagna souvent du 3 septembre au 21
novembre. Ce fut encore par LE MÉDICIN qu'on rouvrit le théâtre en
février 1667, après trois mois d'interruption.
Molière créa Sganarelle, Mlle Molière, Lucinde. Pour les autres rôles,
nous n'avons que des conjectures. Mais, d'après l'état de la troupe et
l'emploi des comédiens, nous pouvons donner comme à peu près
certaine la distribution suivante:
Sganarelle..... MOLIÈRE.
Valère......... DU CROISY.
Léandre........ LA GRANGE.
Géronte........ L. BÉJART.
Lucas.......... LA THORILLIÈRE.
M. Robert...... DE BRIE.
Perrin......... DE BRIE.
Thibaut........ HUBERT.
Lucinde........ Mlles MOLIÈRE.
Martine........ DE BRIE.
Jacqueline..... MADELEINE BÉJART.
Depuis Molière, la tradition de Sganarelle s'est transmise par Rosimond,
Poisson, La Thorillière, Montmény, Préville, Dugazon, La Rochelle,
Thénard, Cartigny, Monrose, Samson, Régnier, jusqu'à M. Got, qui le
joue actuellement, et qui ne compte pat de meilleur rôle dans le vieux
répertoire.
La pièce fut publiée au commencement de 1667, chez le libraire Ribou.
L'édition originale, achevée d'imprimerie 24 décembre 1666, renferme
un frontispice gravé qui est bien curieux à étudier au point de vue des
costumes de Géronte en Pantalon de la Comédie Italienne, et de
Sganarelle en robe de médecin, avec le chapeau «des plus pointus»
dont parle la brochure.[15]
On supprime depuis plus d'un siècle à la Comédie-Française la scène
des paysans Thibaut et Perrin (III, II), qui est cependant des plus
divertissantes. Elle vient trop tard, allègue-t-on, et ne produit que peu
d'effet après les étincelantes folies du second acte. Il faudrait au moins
tenter l'expérience. Selon nous, Molière doit toujours être joué dans son
intégralité. L'épisode, ici, tient bien à la pièce et ne saurait ralentir
l'action, puisqu'il donne à Sganarelle l'occasion d'exercer impunément
le pouvoir de sa prétendue science, en fournissant à Molière de
nouveaux traits contre les médecins, qu'il n'attaquera plus que deux fois,
dans POURCEAUGNAC et LE MALADE IMAGINAIRE.
Pourquoi, dans cette dernière pièce, supprime-t-on la moitié du rôle de
Béralde, sous prétexte qu'une discussion sur la médecine fait longueur,
n'arrivant qu'au troisième acte, après la grande scène de MM. Diafoirus
père et fils, où le rire atteint son maximum d'intensité? C'est, à mon
sens, priver la pièce de ce qu'elle a de plus profond et de plus durable.
GEORGES MONVAL.
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
COMÉDIE EN TROIS ACTES
LES PERSONNAGES
SGANARELLE, mari de Martine. MARTINE, femme de Sganarelle.
M. ROBERT, voisin de Sganarelle. VALÈRE, domestique de Géronte.
LUCAS, mari de Jacqueline. GÉRONTE, père de Lucinde.
JACQUELINE, nourrice chez Géronte, et femme de Lucas. LUCINDE,
fille de Géronte. LÉANDRE, amant de Lucinde. THIBAUT, père de
Perrin, paysan. PERRIN, fils de Thibaut, paysan.
ACTE PREMIER
SCÈNE PREMIÈRE
SGANARELLE, MARTINE, paroissant sur le théâtre en se
querellant.
SGANARELLE.
NON, je te dis que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et
d'être le maître.
MARTINE.
Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne
me suis point mariée avec toi pour souffrir tes fredaines.
SGANARELLE.
O la grande fatigue que d'avoir une femme! et qu'Aristote a bien raison
quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon!
MARTINE.
Voyez un peu l'habile homme, avec son benêt d'Aristote!
SGANARELLE.
Oui, habile homme. Trouve-moi un faiseur de fagots qui sache, comme
moi,
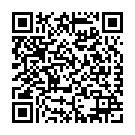
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



