venus à se raconter eux-mêmes et à se peindre!
Leur portrait est celui de tous; chacun reconnaît dans les aventures de
leur esprit ses propres aventures morales et philosophiques. De là
l'intérêt qu'on prend à leurs confidences. Quand ils parlent
d'eux-mêmes, c'est comme s'ils parlaient de tout le monde. La
sympathie est le doux privilège de la médiocrité. Leurs aveux, quand
nous les écoutons, nous semblent sortir de nous-mêmes. Leur examen
de conscience est aussi profitable à nous qu'à eux. Leurs confessions
forment un manuel de confession à l'usage de la communauté tout
entière. Et ces sortes de manuels contribuent à l'amélioration de la
personne morale, quand toutefois le péché y est représenté sans
atténuations hypocrites et surtout sans ces grossissements horribles qui
produisent le désespoir. Si j'ai, çà et là, un peu parlé de moi dans nos
causeries, ces considérations me rassurent.
On ne trouvera pas plus dans ce volume que dans le précédent une
étude approfondie de la jeune littérature. La faute en est sans doute à
moi qui n'ai su comprendre ni la poésie symboliste ni la prose
décadente.
On m'accordera peut-être aussi que la jeune école ne se laisse pas
pénétrer aisément. Elle est mystique et c'est une fatalité du mysticisme
de demeurer inintelligible à ceux qui ne mènent pas la vie du sanctuaire.
Les symbolistes écrivent dans un état particulier des sens; et il faut,
pour communier avec eux, se trouver dans une disposition analogue. Je
le dis sans raillerie: leurs livres, comme ceux de Swedenborg ou ceux
d'Allan Kardec, sont le produit d'une sorte d'extase. Ils voient ce que
nous ne voyons pas. On a essayé d'une explication plus simple: ce sont
des mystificateurs, a-t-on dit. Mais, quand on y réfléchit, on ne trouve
jamais dans la fraude et l'imposture les raisons véritables d'un
mouvement ou littéraire ou religieux, si petit qu'il soit. Non, ce ne sont
pas des mystificateurs. Ce sont des extatiques. Deux ou trois d'entre
eux sont tombés en crise et tout le cénacle a déliré; car rien n'est plus
communicatif que certains états nerveux. Loin de mettre en doute les
effets merveilleux de l'art nouveau, je les tiens pour aussi certains que
les miracles qui s'opéraient sur la tombe du diacre Pâris. Je suis sûr que
le jeune auteur du Traité du verbe parle très sérieusement quand il dit,
assignant au son de chaque voyelle une sonorité correspondante: «A
noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu.» Devant une telle affirmation, il
y a quelque frivolité d'esprit à sourire et à se moquer. Pourquoi ne pas
admettre que si l'auteur du traité du verbe dit qu'A est noir et qu'O est
bleu, c'est parce qu'il le sent, parce qu'il le voit, parce qu'en effet les
sons, comme les corps, ont réellement pour lui des couleurs? On
cessera d'en douter quand on saura que le cas n'est point unique, et que
des physiologistes ont constaté chez un assez grand nombre de sujets
une aptitude semblable à voir les sons. Cette sorte de névrose s'appelle
l'audition colorée. J'en trouve la description scientifique dans un extrait
du Progrès médical, cité par M. Maurice Spronck à la page 33 de ses
Artistes littéraires: «L'audition colorée est un phénomène qui consiste
en ce que deux sens différents sont simultanément mis en activité par
une excitation produite par un seul de ces sens, ou, pour parler
autrement, en ce que le son de la voix ou d'un instrument se traduit par
une couleur caractéristique et constante pour la personne possédant
cette propriété chromatique. Ainsi, certains individus peuvent donner
une couleur verte, rouge, jaune etc., à tout bruit, à tout son qui vient
frapper leurs oreilles.» (J. Baratoux, le Progrès médical, 10 décembre
1887 et nos suiv.) L'audition colorée détermine, dans les esprits doués
pour l'art et la poésie, un nouveau sens esthétique, auquel répond la
poétique de la jeune école.
L'avenir est au symbolisme si la névrose qui l'a produit se généralise.
Malheureusement M. Ghil dit qu'O est bleu et M. Raimbault dit qu'O
est rouge. Et ces malades exquis se disputent entre eux, sous le regard
indulgent de M. Stéphane Mallarmé.
Je comprends que les adeptes de l'art nouveau aiment leur mal et même
qu'ils s'en fassent gloire; et, s'ils méprisent quelque peu ceux dont les
sens ne sont pas affinés par une si rare névrose, je ne m'en plaindrai pas.
Il serait de mauvais goût de leur reprocher d'être des malades. J'aime
mieux, me plaçant dans les plus hautes régions de la philosophie
naturelle, dire avec M. Jules Soury: «Santé et maladie sont de vaines
entités.» Apprenons, avec le gracieux Horatio du poète, qu'il y a plus de
choses dans la nature que dans nos philosophies, si larges qu'elles
soient, et gardons-nous de croire que le dédain soit le comble de la
sagesse.
On ne
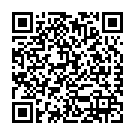
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



