qu'il
ne serait pas désavoué par l'Allemagne.
Au mois d'octobre 1886, M. Tisza s'exprima ainsi: «Lorsque j'ai eu
pour la première fois, en 1868, l'occasion de me prononcer sur la
question d'Orient, j'ai déclaré que s'il se produisait des changements
dans cette région, nos intérêts exigeaient que les populations qui
habitent ces pays devinssent des États indépendants. Je pense, comme
notre ministre des affaires étrangères, que cette solution est encore
aujourd'hui celle qui répond le mieux aux intérêts de notre monarchie et
que celle-ci, repoussant toute idée d'agrandissement ou de conquête,
doit employer tous ses efforts et toute son influence à favoriser le
développement de ces États et à empêcher l'établissement, non admis
par les traités, du protectorat ou de l'influence prépondérante d'une
puissance étrangère dans la presqu'île des Balkans... Le gouvernement
s'en tient à l'opinion déjà plusieurs fois exprimée par lui que, d'après les
traités existants, aucune puissance n'est autorisée à prendre dans la
péninsule des Balkans l'initiative d'une action armée isolée, non plus
qu'à placer cette région sous son protectorat, et qu'en général toute
modification dans la situation politique ou dans les conditions
d'équilibre dans les pays balkaniques ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un
accord des puissances signataires du traité de Berlin.»
Le 13 novembre, au sein de la commission des affaires étrangères de la
Délégation hongroise siégeant à Pesth, le comte Kálnoky parla d'une
façon non moins nette, faisant de plus allusion aux alliances sur
lesquelles il croyait pouvoir compter: «Tant que le traité de Berlin est
en vigueur, dit-il, les intérêts de l'Autriche-Hongrie seront en sécurité,
et si nous étions forcés d'intervenir pour faire respecter ce traité, nous
pourrions compter sur la sympathie et sur le concours de toutes les
puissances qui sont décidées à maintenir les traités européens. L'an
dernier, j'ai dit que l'union de la Bulgarie et de la Roumélie n'était pas
contraire à nos intérêts et que c'était la Turquie qui avait négligé de
restaurer en Roumélie l'autorité qui lui était garantie par le traité de
Berlin. Si cependant la Russie avait pris prétexte de cette union pour
envoyer un commissaire en Bulgarie et pour y prendre en mains les
rênes du gouvernement, et si elle avait pris des mesures pour occuper
les ports ou le pays tout entier, nous aurions, quoi qu'il pût arriver, pris
une décision. Mais le gouvernement crut qu'il était nécessaire d'abord
de prévenir des actes semblables, et c'est dans ce sens que nous avons
agi. Je pense qu'il est désirable que les discussions de nos Délégations
montrent que personne dans notre monarchie ne veut la guerre. Tous
nous désirons la paix, mais point cependant à tout prix.»
Ces paroles de MM. Kálnoky et Tisza signifiaient clairement qu'une
intervention armée de la Russie en Bulgarie serait un casus belli. Elles
répondaient au sentiment général de l'Autriche-Hongrie, car les deux
présidents élus des Délégations, M. Smolka pour la Cisleithanie, et M.
Tisza, le frère du ministre, pour la Transleithanie, avaient, à l'ouverture
des séances, prononcé des discours encore plus fermes et même plus
belliqueux. «Les peuples de la monarchie, et en première ligne les
Hongrois, avait dit M. Tisza, pensent avec raison que les grands intérêts
qu'a le pays en Orient ne sauraient, à aucun prix, être abandonnés et
qu'il faudrait les sauvegarder, dût-on même pour cela affronter un
conflit armé.» De son côté, M. Smolka, après avoir constaté que
l'empereur François-Joseph a su maintenir la paix, avait posé la
question de savoir si, en présence des graves événements extérieurs,
cette même paix est assurée pour l'avenir, et il avait répondu en élevant
des doutes à cet égard. «Fidèle à sa tradition, avait ajouté M. Smolka, la
Délégation, cette fois encore, ne se refusera pas à reconnaître que
maintenant, plus que jamais, il convient de tout mettre en oeuvre pour
que l'Autriche-Hongrie soit à même de prendre, dans le conseil des
nations, la place qui impose le respect à laquelle elle a droit, de telle
sorte qu'on sache bien que ses peuples loyaux sont fermement résolus à
sauvegarder, quoi qu'il arrive, sa haute situation, à la défendre par tous
les moyens, même par l'ultima ratio.»
Dans son discours du 13 novembre, le comte Kálnoky avait clairement
fait entendre qu'en barrant le chemin à la Russie, il pouvait compter sur
l'appui de l'Angleterre et de l'Italie. «Les vues identiques, avait-il dit,
du gouvernement anglais, au sujet de l'importante question européenne
engagée en ce moment, et son désir de maintenir la paix nous
permettent d'espérer que l'Angleterre se joindrait aussi à nous, en cas de
nécessité.»
Quant à l'Italie, il avait insisté sur les relations amicales existant entre
ce pays et l'Autriche-Hongrie et il avait admis «toute l'importance des
intérêts de l'Italie comme puissance méditerranéenne, qui ne pouvait
voir sans s'émouvoir un changement dans la balance des pouvoirs en
Orient. L'Italie, de son
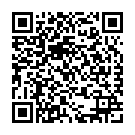
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



