sont deux statues à demi-couchées, vêtues de long, et ayant des tours
sur leurs têtes. Celle qui tient sur ses genoux une couronne fermée et
fleurdelisée, représente la France. L'autre tient un petit bouclier et
quelques dards, et désigne l'Espagne. Elles se donnent la main en signe
d'amitié et d'alliance.
«L'himen qui est plus haut, au milieu d'un attique en manière de
piédestal continu, semble approuver et confirmer cette union qu'il a fait
naître. D'une main il tient son flambeau allumé, et de l'autre un
mouchoir. Les extrémités de ce piédestal continu sont terminées par
deux pyramides, aux pointes desquelles sont des fleurs de lys doubles
et dorées de même que les boules qui portent ces pyramides. Tontes ces
figures sont de Vanopstal, et de quatre pieds plus grandes que le
naturel.
«L'inscription qui est gravée en lettres d'or sur la grande table de
marbre noir dont j'ai parlé, explique toute cette composition en nous
disant que la paix des Pyrénées a été faite et cimentée par les armes
victorieuses de Louis XIV, par les heureux conseils de la Reine Anne
d'Autriche sa mère, par l'auguste mariage de Marie-Thérèse d'Autriche
et par les soins assidus du Cardinal Mazarin.
«Voici les termes dans lesquels cette inscription est conçue:
Paci victricibus LVDOVICI XIV. Armis. Felicibus ANNÆ conciliis
augustis. M. THERESIÆ nuptiis, assiduis Julii Cardinalis MAZARINI
Curis Portæ fondatæ æternum firmatæ Præfectus Urbis Ædilesque
sacravere Anno M. DC. LX
«Les deux portes qui sont aux côtés de cette du milieu qui est la plus
grande, n'ont été percées qu'en 1672. Comme il paroit par les
inscriptions qui sont dans deux tables de l'attique sur l'une desquelles
on lit:
LUDOVIGO MAGNO Præfectus et Ædiles Anno R. S. H.[12] 1672.
«Sur l'autre de ces deux portes est écrit:
Quod Urbem auxit, Ornavit, Locupletavit. P. C.[13].
[Note 12: R. S. H. signifient: Reparatæ salutis hominum.]
[Note 13: P. C. signifient: Posuerunt Consules.]
«Avant de quitter cette porte, je dois remarquer qu'elle est bâtie sur une
des culées du Pont Dormant, ainsi nommé à cause que l'eau qui est
dessous ne coule point, et est une eau dormante.»
Enfin, on construisit les deux corps de garde avec fontaine publique, de
la place Saint-Antoine et devant la Bastille (rue Saint-Antoine en face
de l'entrée de la forteresse).
[Illustration]
DESCRIPTION DE LA BASTILLE EN 1789
EN 1789, la Bastille se composait de huit grosses tours rondes de 73
pieds de haut avec des murs de 6 pieds d'épaisseur. Elles étaient reliées
par des massifs de même hauteur et de 10 pieds de large.--L'ensemble
de ces tours et de ces massifs affectait la forme d'un parallélogramme
irrégulier, légèrement en saillie du côté du faubourg. Les plates-formes
garnies de créneaux et de machicoulis étaient armées de 15 pièces de
canons.
Un fossé large et profond l'isolait complètement.
C'est en 1553, quand on modifia une partie des fortifications de la
capitale, que fut construit, tel qu'il était en 1789, le bastion[14] destiné
a protéger la Bastille en croisant ses feux avec celui de la poudrière[15]
et celui de Saint-Antoine[16].
[Note 14: On lit dans Piganiol de la Force (1742), t. IV, p. 420: «Les
fortifications qu'on y voit furent commencées le 11 d'Août de l'an 1533
et ne furent achevées qu'en 1559. Elles consistent en une courtine
flanquée de bastions, et bordée de larges fossés à fond de cuve. Les
propriétaires de Paris furent taxés pour cette dépense, depuis quatre
livres, jusqu'à vingt-quatre livres tournois.»]
[Note 15: Ce bastion était situé à peu près vers le milieu du boulevard
Bourdon actuel.]
[Note 16: Cet autre bastion s'élevait sur l'emplacement actuel des
premiers numéros pairs du boulevard Beaumarchais.]
Chaque tour avait son nom: la tour de la Chapelle (À du plan, page 60)
et celle du Trésor (B) furent les premières édifiées. Peu après on
construisit la tour de la Liberté (C) et celle de la Bertaudière (D). À cet
ensemble de quatre tours on ajouta celles du Coin (E) et du Puits (F).
Enfin la tour de la Comté (G) et celle de la Bazinière (H) furent élevées
les dernières.
Tour de la Chapelle.--C'est dans cette tour, qu'au XVe siècle, se
trouvait la chapelle de la Bastille qui fut ensuite transférée dans
l'épaisseur du massif entre la tour de la Liberté et celle de la
Bertaudière (P). Linguet en décrit ainsi l'intérieur: «Dans le mur d'un de
ses côtés, celui qui faisait face à l'autel, il y avait six petites niches sans
jour ni air. On y enfermait le prisonnier, qui ne pouvait voir l'officiant
que par une lucarne vitrée et grillée, semblable à un tuyau de lunette.
En revanche, il avait devant les yeux un tableau représentant Saint
Pierre aux liens.»
Tour du Trésor.--Ainsi nommée lorsque Henri IV y déposa les
économies destinées à créer le Trésor de l'État. Marie de Médicis,
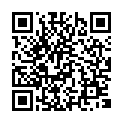
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



