sont dans
les intérêts, dans les passions, et jusque dans les consciences, on ne
peut en saisir les fils, chacun s'entend sans se communiquer, ou plutôt
tout est communication; c'est une sympathie générale et simultanée.
Ce foyer répandait ses feux, gagnait de proche en proche; il attaquait la
puissance de Napoléon dans l'opinion de toute l'Allemagne, s'étendait
jusqu'en Italie, et menaçait toute son existence. Déjà l'on avait pu voir
que, si les circonstances nous devenaient contraires, les hommes ne
manqueraient pas pour les seconder. En 1809, même avant le malheur
d'Esslingen, c'étaient des Prussiens qui, les premiers, avaient osé lever
contre Napoléon l'étendard de l'indépendance. Il les avait fait jeter dans
les fers destinés aux galériens: tant ce cri de révolte, qui répondait à
celui des Espagnols, et pouvait devenir général, lui avait paru important
à étouffer.
Enfin, sans toutes ces causes de haine, la position de la Prusse entre la
France et la Russie obligeait Napoléon à y être le maître: il ne pouvait y
régner que par la force; il ne pouvait y être fort qu'en l'affaiblissant.
Il ruinait ce pays, sachant bien pourtant que la pauvreté rend audacieux;
que l'espoir de gagner devient seul maître chez ceux qui n'ont plus rien
à perdre; qu'enfin, ne leur laisser que du fer, c'était les forcer de s'en
servir. Aussi, dès que l'année 1812 s'approcha, avec la terrible lutte
qu'elle apportait dans son sein, Frédéric, inquiet et fatigué de son
asservissement, voulut en sortir par une alliance ou par la guerre. Ce fut
en mars 1811 qu'il s'offrit comme auxiliaire de Napoléon pour
l'expédition qui se préparait. Dans le mois de mai, et sur-tout en août
suivant, il renouvelle cette proposition, et comme elle reste sans
réponse satisfaisante, il déclare que les grands mouvemens militaires
qui environnent, qui traversent, ou épuisent la Prusse, lui font craindre
qu'on ne médite son entière destruction; «il arme donc, puisque les
circonstances en imposent impérieusement la nécessité, et que mieux
vaut mourir l'épée à la main que de succomber avec opprobre.»
On a dit qu'en même temps Frédéric offrit secrètement à Alexandre
Graudentz, ses magasins, et lui-même à la tête de tous ses sujets
insurgés, si l'armée russe s'avançait jusqu'en Silésie. S'il faut en croire
les mêmes rapports, cette proposition plut à Alexandre. Il envoie
aussitôt à Bagration et à Witgenstein des ordres de marche cachetés.
Ces généraux ne devaient les ouvrir qu'à l'a réception d'une nouvelle
lettre de leur empereur, que ce prince n'écrivit pas; il changea de
résolution, soit qu'il n'osât pas commencer le premier une si grande
guerre, ou qu'il voulût mettre la justice du ciel et l'opinion des hommes
de son côté, en ne paraissant pas l'agresseur; soit plutôt que Frédéric,
moins inquiet des projets de Napoléon, se fût décidé à suivre sa fortune;
soit, enfin, que les nobles sentimens qu'Alexandre exprima dans sa
réponse à ce prince aient été ses seuls motifs: on assure qu'il lui écrivit
«que, dans une guerre qui pouvait commencer par des revers, et où il
faudrait de la persévérance, il ne se sentait assez de courage que pour
lui seul, et que le malheur d'un allié ébranlerait peut-être sa résolution;
qu'il répugnerait à enchaîner la Prusse à sa mauvaise fortune; que
bonne, il la lui ferait toujours partager, quel qu'eût été le parti que la
nécessité l'aurait forcé de prendre.»
Un témoin, subalterne à la vérité, mais enfin un témoin, affirme ces
détails. Au reste, qu'un tel conseil ait été donné par la générosité ou par
la politique d'Alexandre, ou que la nécessité ait seule déterminé
Frédéric, ce qui est certain, c'est qu'il était temps pour lui qu'il se
décidât: car, en février 1812, ces pourparlers avec Alexandre, s'ils
existèrent, ou l'espoir d'obtenir de meilleures conditions de la France,
l'ayant fait hésiter à répondre aux propositions définitives de Napoléon,
celui-ci, impatient, fit occuper encore plus fortement Dantzick, et
poussa Davoust en Poméranie; ses ordres, pour cet envahissement d'une
province suédoise, furent répétés, pressans, et motivés, d'abord, sur le
commerce illicite de la Poméranie avec les Anglais, et ensuite sur la
nécessité de forcer la cour de Berlin à accéder à ses propositions. Le
prince d'Eckmühl reçut même l'ordre de se tenir prêt à s'emparer
subitement de toute la Prusse et de son roi, si ce monarque, huit jours
après la réception de cette instruction, n'avait point conclu l'alliance
offensive que la France lui dictait; mais, tandis que le maréchal traçait
le peu de marches nécessaires pour cette opération, il apprit que le traité
du 24 février 1812 était ratifié.
Cette soumission n'a point encore rassuré Napoléon. À sa force il ajoute
la feinte: les forteresses que, par pudeur, il laisse à Frédéric, sa défiance
en convoite encore l'occupation: il exige que ce monarque n'entretienne
que cinquante ou quatre-vingts invalides dans les unes; il veut qu'il
souffre
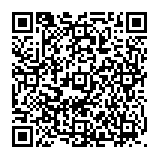
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



