de comte
d'Artois s'obstina à la poursuite, malgré leur conseil, et se jeta dans la
ville: ils le suivirent par honneur et furent tous tués.
[Note 20: «Sicut mater infantem.» Lettre de Jacques Molay.]
On avait cru avec raison ne pouvoir jamais faire assez pour un ordre si
dévoué et si utile. Les priviléges les plus magnifiques furent accordés.
D'abord ils ne pouvaient être jugés que par le pape; mais un juge placé
si loin et si haut n'était guère réclamé; ainsi les Templiers étaient juges
dans leurs causes. Ils pouvaient encore y être témoins, tant on avait foi
dans leur loyauté! Il leur était défendu d'accorder aucune de leurs
commanderies à la sollicitation des grands ou des rois. Ils ne pouvaient
payer ni droit, ni tribut, ni péage.
Chacun désirait naturellement participer à de tels priviléges. Innocent
III lui-même voulut être affilié à l'ordre; Philippe le Bel le demanda en
vain.
Mais quand cet ordre n'eût pas eu ces grands et magnifiques priviléges,
on s'y serait présenté en foule. Le Temple avait pour les imaginations
un attrait de mystère et de vague terreur. Les réceptions avaient lieu
dans les églises de l'ordre, la nuit et portes fermées. Les membres
inférieurs en étaient exclus. On disait que si le roi de France lui-même
y eût pénétré, il n'en serait pas sorti.
La forme de réception était empruntée aux rites dramatiques et bizarres,
aux mystères dont l'église antique ne craignait pas d'entourer les choses
saintes. Le récipiendaire était présenté d'abord comme un pécheur, un
mauvais chrétien, un renégat. Il reniait, à l'exemple de saint Pierre; le
reniement, dans cette pantomime, s'exprimait par un acte[21], cracher
sur la croix. L'ordre se chargeait de réhabiliter ce renégat, de l'élever
d'autant plus que sa chute était plus profonde. Ainsi dans la fête des fols
ou idiots (fatuorum), l'homme offrait l'hommage même de son
imbécillité, de son infamie, à l'Église qui devait le régénérer. Ces
comédies sacrées, chaque jour moins comprises, étaient de plus en plus
dangereuses, plus capables de scandaliser un âge prosaïque, qui ne
voyait que la lettre et perdait le sens du symbole.
[Note 21: Voyez plus loin les motifs qui nous ont décidé à regarder ce
point comme hors de doute.--Le XIVe siècle ne voyait probablement
qu'une singularité suspecte dans la fidélité des Templiers aux anciennes
traditions symboliques de l'Église, par exemple dans leur prédilection
pour le nombre trois. On interrogeait trois fois le récipiendaire avant de
l'introduire dans le chapitre. Il demandait par trois fois le pain et l'eau,
et la société de l'ordre. Il faisait trois voeux. Les chevaliers observaient
trois grands jeûnes. Ils communiaient trois fois l'an. L'aumône se faisait
dans toutes les maisons de l'ordre trois fois la semaine. Chacun des
chevaliers devait avoir trois chevaux. On leur disait la messe trois fois
la semaine. Ils mangeaient de la viande trois jours de la semaine
seulement. Dans les jours d'abstinence, on pouvait leur servir trois mets
différents. Ils adoraient la croix solennellement à trois époques de
l'année. Ils juraient de ne pas fuir en présence de trois ennemis. On
flagellait par trois fois en plein chapitre ceux qui avaient mérité cette
correction, etc., etc. Même remarque pour les accusations dont ils
furent l'objet. On leur reprocha de renier trois fois, de cracher trois fois
sur la croix. «Ter abnegabant, et horribili crudelitate ter in faciem
spuebant ejus.» Circul. de Philippe le Bel, du 14 septembre 1307. «Et li
fait renier par trois fois le prophète et par trois fois crachier sur la
croix.» Instruct. de l'inquisiteur Guillaume de Paris. Rayn., p. 4.]
Elles avaient ici un autre danger. L'orgueil du Temple pouvait laisser
dans ses formes une équivoque impie. Le récipiendaire pouvait croire
qu'au delà du christianisme vulgaire, l'ordre allait lui révéler une
religion plus haute, lui ouvrir un sanctuaire derrière le sanctuaire. Ce
nom du Temple n'était pas sacré pour les seuls chrétiens. S'il exprimait
pour eux le Saint-Sépulcre, il rappelait aux juifs, aux musulmans, le
temple de Salomon[22]. L'idée du Temple, plus haute et plus générale
que celle même de l'Église, planait en quelque sorte par-dessus toute
religion. L'Église datait, et le Temple ne datait pas. Contemporain de
tous les âges, c'était comme un symbole de la perpétuité religieuse.
Même après la ruine des Templiers, le Temple subsiste, au moins
comme tradition, dans les enseignements d'une foule de sociétés
secrètes, jusqu'aux Rose-Croix, jusqu'aux Francs-Maçons[23].
[Note 22: Dans quelques monuments anglais, l'ordre du Temple est
appelé Militia Templi Salomonis. (Ms. Biblioth. Cottontanæ et
Bodleianæ.) Ils sont aussi nommés Fratres militiæ Salomonis, dans une
charte de 1197. Ducange. Rayn., p. 2.]
[Note 23: Il est possible que les Templiers qui échappèrent se soient
fondus dans des sociétés secrètes. En Écosse, ils disparaissent tous,
excepté deux. Or, on a remarqué que les plus secrets mystères de la
franc-maçonnerie sont réputés
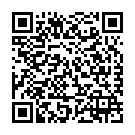
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



