individuels, comme les adjectifs _blanc, rouge, dur_, etc., et les
substantifs abstraits qui y répondent. Les premières de ces idées sont
des êtres[11], les secondes des accidents. Il est resté: 1° Les idées de
certaines choses non sensibles qui sont comme les conceptions
nécessaires de l'esprit (_substance, essence, cause_, etc.), attributs les
plus généraux des choses, analogues aux catégories ou prédicaments
des aristotéliciens. 2° Les idées de certaines qualités essentielles qui
sont la base et la condition des essences; ces idées, difficiles à exprimer,
sont les formes essentielles du péripatétisme et de la scolastique. 3° Les
idées des essences qui sont le fondement des genres et des espèces; ce
sont les universaux proprement dits. 4° Les idées des touts qui sont ou
les collections d'individus autres que les genres et les espèces, ou des
composés déterminés de parties formant ensemble une unité de
conception.
[Note 11: Les premières n'ont pas été constamment et sans exception
mises hors du débat, et nous voyons dans Abélard qu'une secte,
observant que Dieu ne pouvait être ni accident, ni espèce, ni genre, ni
forme, etc., soutenait qu'il n'était rien. Voyez ci-après I. III, c. ii.]
Toutes ces idées ont un caractère commun: elles sont désignées par des
noms généraux, ce qui fait qu'elles peuvent toutes être appelées des
universaux. Sur elles toutes, la querelle des universaux pouvait à la
rigueur s'élever, car toutes étaient atteintes dans leur réalité objective
immédiate par le principe qu'il n'y a de réel que l'individu. Cependant
c'est sur la troisième classe d'idées que la querelle a surtout éclaté.
Voici pourquoi. Si l'on décompose le genre ou l'espèce, on trouve des
réalités incontestables, lorsqu'on arrive aux individus. Cependant la
conception du genre ou de l'espèce n'est pas celle des individus;
qu'est-elle donc? On ne peut lui refuser toute réalité, puisqu'elle
comprend les individus qui sont réels, et cependant, comme elle n'est
pas la conception même des individus qui sont seuls réels, elle est la
conception de quelque chose qui n'est pas réel. Ainsi les idées de genre
et d'espèce n'ont point de réalité immédiate, quoique médiatement elles
soient fondées sur des réalités. De là des équivoques et des difficultés
sans nombre. Les autres idées non sensibles dont les objets se
résolvaient moins facilement en réalités, offraient un caractère plus
évident d'abstraction; c'étaient ces idées scientifiques _d'être, d'essence,
de cause_, au lieu que les idées des genres et des espèces avaient une
face changeante qui piquait la curiosité et embarrassait la subtilité.
Or donc, tandis que les universaux avaient été assez généralement pris
pour des conceptions formées en conséquence plus ou moins éloignée
de l'existence d'individus réels, deux opinions presque absolues se
produisirent au moyen âge. D'un côté, la doctrine de Platon,
imparfaitement connue, qui attribuait aux idées universelles des types
primitifs et des essences immuables, devint l'affirmation directe de
l'existence d'essences universelles subsistant dans les genres mêmes et
les espèces; ce fut là le réalisme. D'un autre côté, la doctrine
aristotélique, portant que la substance proprement dite est
nécessairement particulière, et qu'il n'y a point d'existence universelle,
quoique les universaux soient les conceptions générales de réalités
individuelles, s'exagéra à ce point de ne plus même les admettre à titre
de conception, et outrant le principe du sensualisme, elle les réduisit à
de purs noms, _meroe voces, flatus vocis_. Ce fut là le nominalisme.
Roscelin, et probablement Jean le Sourd, son maître, traita de noms et
de mots, non-seulement les genres et les espèces, mais tout ce que
l'idéologie appelle idées abstraites. Comme il n'admit que les individus,
il nia les touts et les parties; les touts, en tant que formés d'individus,
les parties, en tant que n'étant pas des individus entiers; de sorte que
pour lui des individus réels composaient des touts imaginaires, et des
parties imaginaires composaient des individus réels. Ces excès
amenèrent l'excès de réalisme où tomba Guillaume de Champeaux, du
moins au témoignage d'Abélard. Il soutint qu'une seule et même
essence existait dans tous les individus, dont la diversité dépendait tout
entière de la variété des accidents. Dans cette doctrine, la diversité des
sujets des accidents semble s'anéantir, et comme toutes les espèces,
aussi bien que les individus, comme tous les genres, aussi bien que les
espèces, tombent sous la loi commune de la conception d'essence, cette
doctrine, si elle a été fidèlement représentée, aurait réduit l'univers à
ces termes: unité de substance, diversité de phénomènes.
Entre ces deux systèmes absolus, Abélard crut trouver la vérité en
prenant un milieu. Il produisit une doctrine qui, sans être neuve pour le
fond, l'était par quelques détails et quelques expressions, et qui a été
tour à tour appelée le conceptualisme ou confondue avec le
nominalisme. En effet, une analyse exacte la réduirait peut-être au
premier de ces systèmes, lequel lui-même penche vers le second.
Cependant il est plus difficile qu'on ne
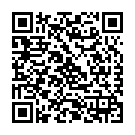
Continue reading on your phone by scaning this QR Code

Tip: The current page has been bookmarked automatically. If you wish to continue reading later, just open the
Dertz Homepage, and click on the 'continue reading' link at the bottom of the page.



